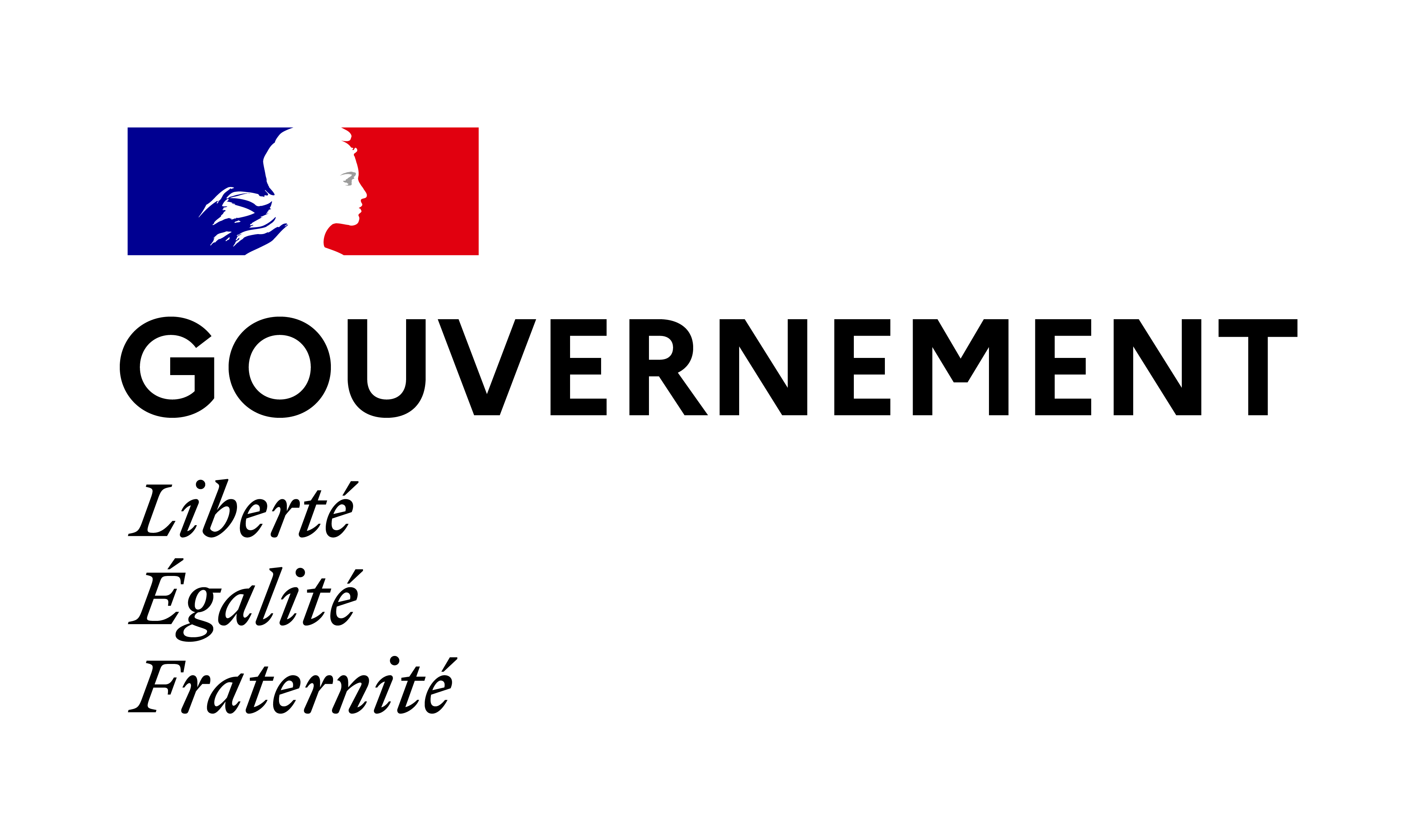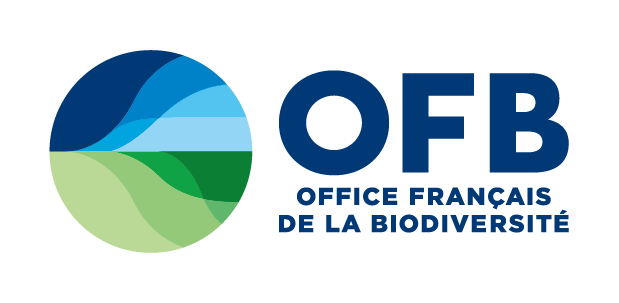Site de Saint Anne - CABioSol

Le Service d’Expérimentation Agroécologique (SEA) géré par la Collectivité territoriale de Martinique est situé au quartier Val-d’Or sur la commune de Sainte-Anne à la pointe sud de l’île. Cette exploitation est soumise aux pédoclimats les plus rudes de Martinique, constituant un défi pour la production légumière du sud.
Le SEA œuvre depuis de nombreuses années sur des thèmes tels que l’élaboration de référentiels pour les cultures agrobiologiques, le concept du jardin créole, la réalisation de lombricompost et le développement durable en élevage. L’observatoire piloté est installé dans le Jardin Créole de l’exploitation et pourra profiter de l’expérience de ses techniciens/ouvriers pour la gestion de parcelles multi culturales. Et ce, avec un accent mis sur des associations avec des cultures délaissées par l’agriculture conventionnelle (Plantes aromatiques et médicinales, Maïs, Haricots/Pois, etc.)
| Climat | Sol |
|
Températures : Minimum annuel de 23 C° Maximum annuel de 30 C° Moyenne annuelle de 27 C° Pluviométrie annuelle : 1500 mm |
Vertisols à montmorillonites, caractéristiques du Sud de la Martinique. |
| Niveaux de pression : Maladies | Niveaux de pression : Ravageurs | Niveaux de pression : Adventices |

|

|

|
Le climat tropical humide est propice au développement quasi-continu de nombreux bioagresseurs. Aussi seules les menaces biotiques ayant un impact notable sont représentées ici. Il en va de même pour les adventices, seules les espèces à croissance rapide ou représentant un danger pour les cultures sont représentées.
Ce site présente les maximums de températures parmi les plus élevés de l’ile, la pression biotique la plus sérieuse vient donc des ravageurs toutes catégories confondues. Et bien que la fourmi ne soit pas reconnue comme un ravageur direct, son impact, même indirect, reste important sur les cultures maraichères et fruitières en Martinique.
En milieu tropical, peu de données sont à ce jour disponibles concernant des systèmes poly culturaux. Sur la Martinique, les filières dites de « diversification » (maraîchage, arboriculture fruitière, plantes aromatiques et légumes racines) ne présentent que peu de structuration à l’échelle du territoire. Cette partie du secteur agricole martiniquais est majoritairement composée de petites exploitations familiales elles même peu structurées avec peu ou pas du tout de main d’œuvre. La production se planifie peu sur le long terme et se décide souvent au gré de la demande immédiate pour les cultures à cycles courts non destinées à l’exportation. Ce type d’exploitation effectue très peu de variations culturales ou même variétales, chaque producteurs étant plus ou moins spécialisés dans 1 à 2 cultures principales. Ce qui laisse peu de marges d’adaptations face aux aléas climatiques ou sanitaires. Ce types d’exploitations accusent régulièrement de sérieuses pertes saisonnières entraînant de nombreuses difficultés de trésoreries.
Les systèmes de cultures diversifiés ne sont que très peu exploités sur le territoire Martiniquais où les filières banane et canne prédominent. Ces systèmes de monocultures intensives sont de fait dépendants des produits phytopharmaceutiques qui engendrent certains risques pour les écosystèmes déjà fragilisés ainsi que pour la santé humaines, la population des Antilles étant déjà touchée par la crise sanitaire liée aux pollution des sols et des cours d’eau à la Chlordécone.
Cette exploitation est entourée d’un paysage agricole essentiellement composé de prairie d’élevage (bovin et ovin). Le vallon est également occupé par l’une des plus importante exploitation productrice de Melon sur l'île. Voisinage qui impact sérieusement la population de ravageurs de la zone, notamment en aleurodes et pucerons, communs à la culture du Melon.
| Système CABIOSOL (- 100 % IFT) | |
|
|
Dispositif expérimental
 |
Le dispositif expérimental propose une parcelle organisée en îlots de cultures associées séparés par des bandes relais. Des rotations à la fois spatiale et temporelle sont réparties sur l’ensemble des ilots de cultures. |
L’enregistrement régulier des variables collectées permet un suivi de la performance globale du système afin de permettre des adaptations tout aussi régulières des règles de décisions. Pour chacune des espèces du système (culture ou relais) les données suivantes sont enregistrées :
-La présences de ravageurs, auxiliaires et symptômes de maladies (hebdomadaire)
-Le stade phénologique et la croissance végétative (hebdomadaire)
-Les pratiques culturales et les rendements de production (quotidien)
Concernant le suivi des réseaux mycorhiziens, des prélèvements racinaires sont effectués en fin de cycles sur des cultures cibles. De plus, des systèmes de piégeage des champignons endomycorhiziens sont mis en place chaque année et viennent compléter les prélèvements de sols et racines réalisés en vue d’analyses de quantification et détermination.
Les aménagements agroécologiques étant au centre de la conception de ce système, ils ont fait l’objet d’un travail préalable à la conception pour la prospection, puis la sélection des espèces relais les plus performantes. Cette performance a été basée sur les services écosystémiques rendus, mais également sur la facilité d’entretien et de multiplication. Ainsi les espèces sélectionnées afin de constituer les bandes relais du projet CABioSol proposent des services écosystémiques à l’ensemble des compartiments du système de culture.
Le compartiment aérien :
-refuges pour insectes auxiliaires
-piégeage de ravageurs
-effet répulsif
Et le compartiment sol :
-Effet répulsif racinaires
-Apports azotés des racines de légumineuses
-Effet mycorhizotrophes, renforçant l’activité du réseau mycorhizien valorisé dans le cadre du projet.
Chacun des ilots de cultures est séparés par des bandes de passages au long desquelles sont installées des bandes relais. L’ilot central de la parcelle étant consacré aux PPAM (et le seul sans rotation spatiale), il a la double fonction de massif fleurie au centre du système de culture.
La parole de l'expérimentateur
Les objectifs de CABioSol correspondant à ceux vers lesquels nous souhaitions nous orienter, nous espérons pouvoir à travers cette expérience trouver la bonne formule et surtout les bonnes associations insectifuges pour les cultures maraichères et vivrières.