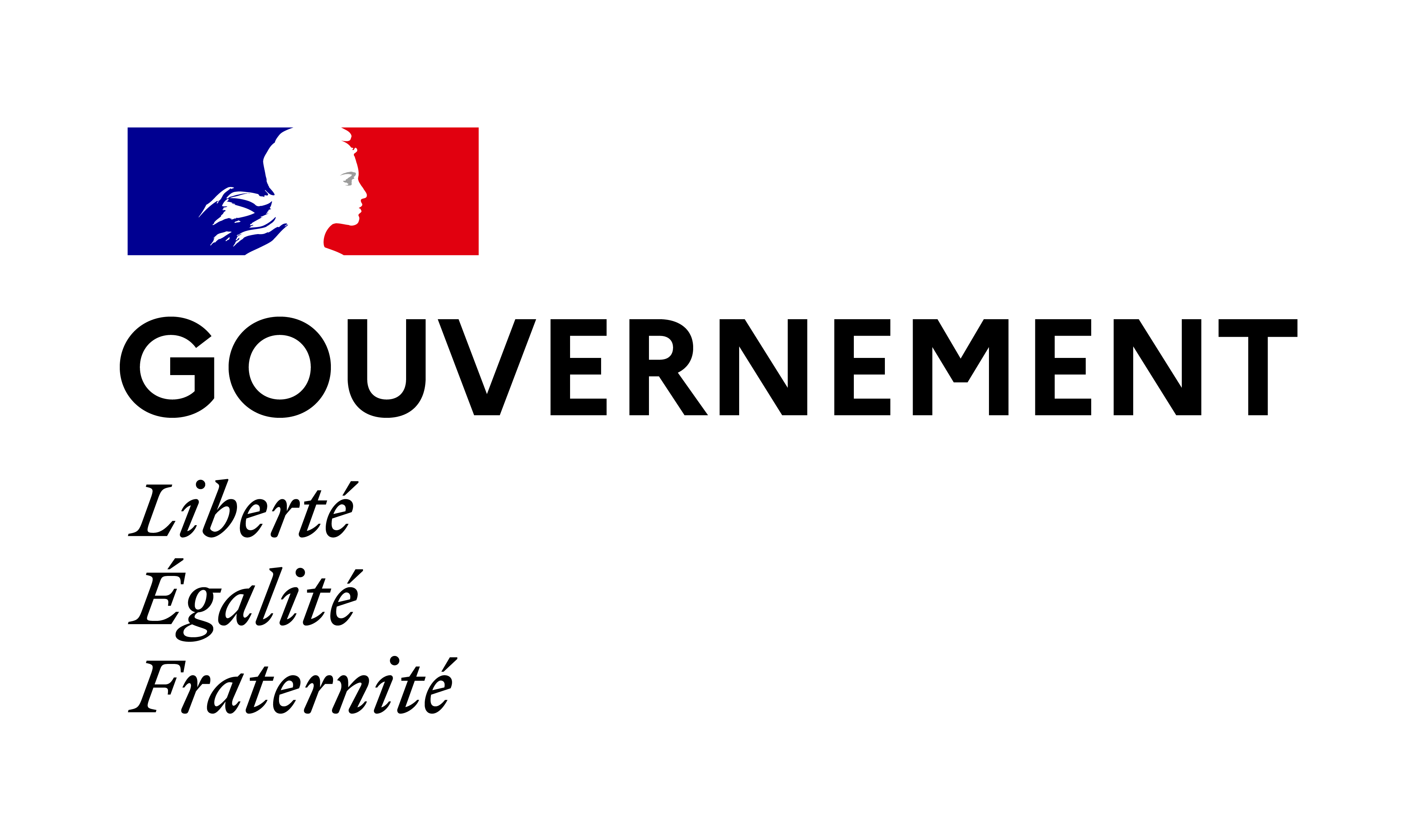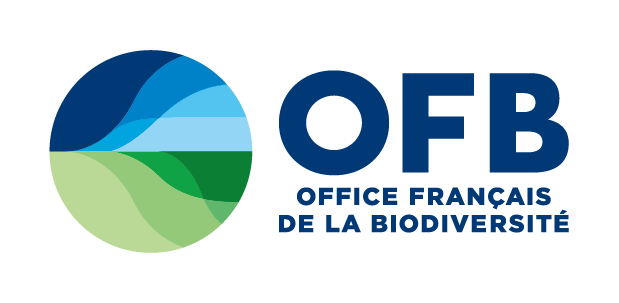Système Module 1 - INRAE UERI Gotheron - ALTO

Conception du système
Le dispositif 'Module 1' a été réalisé en co-conception en 2016-2017. La démarche a mobilisé un ensemble d'acteurs du territoire et de la filière : agriculteurs, animateurs de collectifs agricoles, conseillers, formateurs, expérimentateurs, chercheurs, naturalistes... L'idée a été de partir d'une feuille blanche pour repenser l'espace de production de fruits, avec l'objectif de produire en mobilisant les services écosystémiques plutôt que des intrants. Cette conception agroécologique s'est appuyée sur la diversité des espèces, des variétés, des plantes associées et leur agencement dans le temps et dans l'espace, ainsi que la création d'habitats, pour rendre l'espace de production de fruits très défavorable aux bio-agresseurs et a contrario très favorable à leurs ennemis naturels. Les choix de plantation finaux sont issus de connaissances de nature et d'origine diverses, et de compromis co-construits entre dimensions écologiques, agronomiques (dont partage des ressources entre plantes) et opérationnelles (ex. organisation du travail).
Mots clés :
Arboriculture - Reconception - Biodiversité - Agroécologie - Zéro-phyto
Caractéristiques du système
| Espèce | Variétés | Porte-greffe | Mode de conduite | Distance de plantation | Année d'implantation | Valorisation | Circuit commercial |
| Pommier |
Akane |
M106 |
Forme libre | 4 m x 6 m |
2018 |
Frais/ transformation | Court |
| Florina | 2019 | ||||||
| Ecolette | |||||||
| Reinette Capucins | |||||||
| HoneyCrisp | Pajam2 | 2018 | |||||
| Reine des Reinettes | M106 | ||||||
| Juliet | Franc | ||||||
| Garance | M7 | ||||||
| Pêcher |
Bénédicte |
Montclar |
Gobelet | 4 m x 6 m |
2018 |
Frais/ transformation | Court |
| Maria Bianca | GF677 | ||||||
| Abricotier |
Vertige |
Montclar | Gobelet | 4 m x 6 m |
2018 |
Frais/ transformation | Court |
| Malice | |||||||
| Prunier |
Reine-Claude dorée |
Mirobolan | Gobelet | 4 m x 6 m |
2018 |
Frais/ transformation | Court |
| Reine-Claude de Bavay | |||||||
| Petits Fruits, fruits à coque, divers | Framboise, cassis, groseille, amande, châtaigne, noisette, figue, grenade, kaki... | Selon l'espèce | Selon l'espèce | Variable | 2018 | Frais/ transformation | Court |
|
Système d’irrigation : Asperseurs, irrigation en plein sauf petits fruits (goutte à goutte) Gestion de la fertilisation : Un apport annuel de compost de ferme jeune, épandu en plein (apport d'environ 4t/ha au printemps) ; luzerne de l'inter-rang broyée déportée sur le rang (jusqu'en 2021) puis laissée sur place Infrastructures agro-écologiques : Mare, haies composites, plantes de service (dont aromatiques), pierriers, tas de branches, nichoirs, perchoirs et gîtes à chauve-souris |
 |
|
Agronomiques |
|
| Environnementaux |
|
|
Maîtrise des bioagresseurs |
Le niveau de dégâts des bio-agresseurs est un résultat de l'expérimentation dans un cadre en rupture : dans quelle mesure peut-on produire des fruits sans pesticides en maximisant les biorégulations ? |
|
Socio-économiques |
|
Le mot de l'expérimentateur
Ce système est exploratoire et complexe car il s'appuie sur l'association de plantes pour produire, en utilisant uniquement du compost de ferme et de l'eau comme intrants. Il est porté par toute une équipe et un collectif de partenaires. En ce sens, il a été riche en interactions, lors de sa conception, de son pilotage, de son évaluation, et également lors de toutes les visites et temps d'échanges autour des questions posées par la diversification du verger (dont les Cafés Agro). Je souhaite remercier tout particulièrement les collègues et participant.es à cette démarche, qui ont permis de transformer une idée en un dispositif opérationnel, qui intègre et produit des connaissances pour repenser l'espace de production de fruits.
Ce verger très diversifié est jeune, et il n'est pas possible d'extrapoler les résultats des premières années, d'autant que les régulations biologiques mettent du temps à se mettre en place (ex. il faut plusieurs années pour qu'une haie pousse). Les premiers suivis attestent d'une bonne implantation des arbres (hors ECA sur abricotiers) et d'un enrichissement de la biodiversité fonctionnelle, avec des taux de prédation et parasitisme élevés, et la régulation des pucerons. Il reste à évaluer dans la durée le contrôle d'autres ravageurs (ex. tordeuses, punaises, mouches), ainsi que les niveaux des productions, faibles à moyens selon les espèces, et fortement impactés par les aléas climatiques ces dernières années (neige précoce, grêle, deux épisodes de gel tardifs, stress thermiques).
Pour finir, ce dispositif n'est pas un modèle à transposer en l'état en tant que verger commercial : il est à considérer comme un support de preuve de concept, comme un incubateur d'idées et de connaissances, et comme un lieu de partage d'expériences pour approprier la démarche dans d'autres contextes et avec d'autres objectifs. Sa résilience à long terme reste à évaluer mais il constitue déjà un espace qui contribue à réconcilier production et conservation de la biodiversité. A suivre !
S. Simon
Dans ce verger 0 phyto, les stratégies mises en oeuvre sont principalement préventives : choix d'un matériel végétal peu sensible aux bio-agresseurs, mesures pour favoriser les auxiliaires dans leur diversité, prophylaxie, et agencement spatial visant à limiter l'installation et la dispersion des ravageurs et maladies dans le verger...
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.
| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Désherbage mécanique sur le rang (début de vie du verger) | Utilisé de la plantation (2018) jusqu'au printemps 2021, pour limiter la concurrence du couvert avec les fruitiers. | Pratique équivalente à celle d'un verger en désherbage mécanique, avec tolérance d'herbe pour limiter le nombre de passages. Permet de limiter la présence des campagnols près des fruitiers. |
| Enherbement inter-rang | Verger implanté dans une luzernière après destruction de la luzerne sur les rangs de plantation. Couvert en évolution spontanée à partir de cette luzernière. Entretien par broyage alterné 1 rang sur 2 soit au maximum 25% de la surface broyée par passage. Passages motivés par les opérations culturales, pour favoriser la prédation du campagnol sur pommiers (automne), et pour fertiliser (la luzerne est utilisée comme amendement sur place). |
Demande de la vigilance par rapport au campagnol (piégeage si traces d'activité en augmentation à proximité des pommiers). Des compromis sont parfois à faire entre maintien du couvert pour la biodiversité et besoins pour les opérations culturales ou la gestion du campagnol. |
| Enherbement du rang (à partir 4e feuille) | Couvert spontané, géré par broyage déporté et/ou débroussailleuse autour des troncs et des asperseurs. Mêmes principes de gestion que pour l'inter-rang. | Demande de la vigilance par rapport au campagnol (piégeage si traces d'activité en augmentation à proximité des pommiers). |
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.
| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Contrôle génétique |
-Utilisation de variétés de pommiers peu à moyennement sensibles au puceron cendré pour limiter les infestations. -Utilisation d'une variété de pommiers précoce pour limiter les populations de carpocapse (évitement). -Utilisation de porte-greffes forts pour avoir des arbres les plus autonomes possible et permettre de récupérer après un stress biotique ou abiotique. |
Le puceron cendré a été présent en phase juvénile du verger, ainsi que le puceron vert du pommier Aphis spp. ; pas d'infestation en 2022-2023 (quelques foyers, pas de progression de l'infestation). Un différentiel de sensibilité au puceron cendré a été observé au sein de cet ensemble de variétés peu sensibles. Vigueur à gérer sur le prunier. |
| Contrôle cultural | Fertilisation modérée et pas de pic de minéralisation. | Le type de fertilisation utilisé (compost de ferme jeune à faible dose ~4t/ha) en fin d'hiver et l'utilisation de légumineuses ont permis une bonne installation des arbres. |
| Lutte biologique par conservation |
Habitats et ressources (fleurs et proies alternatives) tout au long de la saison. Augmentorium carpocapse (prototypes) -cf piégeage massif |
Taux de prédation et de parasitisme élevés. Présence mais pas de dégâts de pucerons depuis plantation pour les fruits à noyau, et depuis 2 ans (après phase juvénile) pour les pommiers. NB : présence mais faible niveau d'infestation de tordeuse orientale/anarsia sur pêchers (pousses, fruits). |
| Lutte biologique : effets piège et barrière-dilution |
Agencement spatial :
-Alternance des espèces entre rangs (cercles) pour limiter les infestations. |
La variété Florina installée dans le cercle de pommiers extérieur se comporte comme une variété piège : le puceron cendré s'y installe et s'y reproduit à son vol de retour à l'automne mais ne se développe pas au printemps du fait de la résistance de cette variété. La variété constitue donc une 'impasse' pour ce ravageur. Les rangs de pommiers intérieurs tendent à être moins infestés que les rangs extérieurs en 2021 (faibles niveaux d'infestation en 2022, 2023 ne permettant pas d'analyser). L'analyse pluri-annuelle reste à réaliser. |
| Lutte physique : piégeages |
Piégeage mécanique des campagnols. Piégeage massif carpocapse entre générations : entre G1 et G2, au cours G2-G3 puis sur populations diapausantes à l'automne (~5 sessions annuelles selon températures et développement carpocapse).
Piégeage massif des forficules dans les 15 jours précédant la récolte pour limiter dégâts sur fruits et développement monilia.
|
Piégeage campagnol organisé selon les traces d'activités à proximité des pommiers. Utilisation de modèle de développement du carpocapse pour limiter le nombre de sessions. Les bandes relevées (et les pommes piquées) sont mises dans des augmentoriums ('container' avec face grillagée avec une maille qui empêche les carpocapses de sortir mais permet aux parasitoïdes et aux petits auxiliaires d'émerger). Utilisation de carton ondulé dans un tube PVC fixé sur le tronc pour rapidité de récolte des forficules, passage 2 fois par semaine. Les forficules sont relâchés dans la haie de bordure. Dégâts en baisse en 2023 (par rapport à 2022) après mise en place piégeage : ~10-100 forficules récoltés par arbre et par passage (mais dispositif ne permettant pas de suivi de l'efficacité par rapport aux dégâts sur fruits). |
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.
| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Contrôle génétique | Utilisation de variétés peu à moyennement sensibles à un ensemble de maladies. |
Pas de tavelure détectée dans la parcelle (variétés peu sensibles et résistantes). Faible présence d'oïdium (pommiers, pêchers). Présence de cloque faible à moyennement élevée selon les années mais les arbres ont ensuite la capacité à repousser (symptômes difficilement visibles dès juin). En question : son impact sur le rendement ? |
| Contrôle cultural |
Broyage de la litière foliaire pour limiter la tavelure (pommier), |
Broyage de litière réalisé avec le broyage des bois de taille en hiver. |
| Contrôle cultural | Enlèvement des rameaux oïdiés (oïdium primaire, pommier), des rameaux moniliés après fleur sur abricotiers, et des momies sur fruits à noyaux. |
Réalisé lors de la taille hivernale, sauf passage spécifique pour abricotiers. Niveau d'infection sur rameaux faible et ne progressant pas d'une année sur l'autre. |
| Contrôle cultural | Gestion du microclimat : arrosages les matins pour ne pas avoir d'humidité sur le feuillage sur des périodes prolongées. | L'arrosage de nuit (pour faciliter les 'tours d'eau') sur pruniers s'est accompagné d'un important développement de rouille. L'arrosage est dorénavant en journée. |
|
Lutte biologique |
L'absence de protection fongique peut favoriser la présence d'antagonistes. | Il serait intéressant à évaluer (microbiote) mais non réalisé dans le cadre du projet. |
Niveau de maîtrise de bioagresseurs par rapport aux objectifs fixés (vert=satisfaisant; jaune=moyennement satisfaisant; rouge=non satisfaisant; gris=sans objet). Plantation 2018.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| POMMIER | ||||||
| Puceron cendré | ||||||
| Puceron vert pommier | ||||||
| Carpocapse | pas de fruits | pas de fruits | ||||
| Punaises | pas de fruits | pas de fruits | ||||
| Tavelure pommier | ||||||
| Oïdium pommier | ||||||
| PECHER | ||||||
| Pucerons | ||||||
| Tordeuse orientale | ||||||
| Cloque | ||||||
| Monilia fruits | pas de fruits | pas de fruits | pas de fruits | pas de fruits (gel) | peu de fruits (gel) | |
| Cicadelle verte | ||||||
| ABRICOTIER | ||||||
| Pucerons | ||||||
| Forficules | pas de fruits | pas de fruits | peu de fruits | peu de fruits | ||
| Anarsia | ||||||
| Monilia fleur | ||||||
| Rouille | ||||||
| ECA | ||||||
| PRUNIER | ||||||
| Pucerons | ||||||
| Tordeuse/carpo prune | pas de fruits | pas de fruits | pas de fruits | pas de fruits | ||
| Rouille | ||||||
| PETITS FRUITS | ||||||
| D. suzukii framboise | ||||||
| D. suzukii groseilles, cassis | ||||||
| FIGUIER | ||||||
| Bioagresseurs figuier | ||||||
| AMANDIER | ||||||
| Eurytoma | ||||||
| Autres bioagresseurs amandier | ||||||
| TOUS FRUITIERS | ||||||
| Cicadelle bubale | ||||||
| Campagnols | ||||||
Le niveau de dégâts dus aux bioagresseurs varie selon les espèces fruitières et les années. Globalement :
-La présence de luzerne a probablement favorisé les populations de campagnols qui demandent un complément de piégeage à des périodes clés (hiver). Les pommiers sont toutefois la seule espèce à risque, et le total de pertes d'arbres dues au campagnol est de 2 arbres sur les 6 ans. La situation est donc globalement correcte même si une vigilance est requise.
-De même, la luzerne a favorisé la présence de cicadelle bubale en tant que Fabacée hôte, avec d'importantes cicatrices sur bois en verger jeune dues à ce ravageur. La disparition progressive de la luzerne et la croissance des arbres font que cet impact est maintenant très faible.
-Sur petits fruits, Drosophila suzukii affecte principalement les framboises, qui sont fortement infestées en fin de période de récolte (NB : framboisiers non remontants).
-Sur pruniers, l'attaque de rouille en 2020 est principalement liée à une aspersion de nuit (il n'est pas possible de tout arroser dans la journée). La modification de la pratique avec arrosage en début de journée a permis de limiter très fortement la maladie.
-Sur abricotiers, l'ECA est à l'origine de mortalité des arbres (en moyenne 5% des arbres par an) et constitue un verrou majeur pour cette espèce fruitière.
-Sur pêchers, l'attaque de cloque peut être importante certaines années (variétés très peu sensibles mais absence de toute protection). Les arbres ont ensuite la capacité de refaire de la pousse mais cette maladie limite peut-être la production qui n'atteint pas son potentiel.
-Les monilioses occasionnent quelques dessèchements de rameaux sur abricotiers, sans affecter le rendement. Peu/pas de recul sur pêches (monilia sur fruits) avec une seule année de récolte.
-Aucun symptôme de tavelure n'a pour l'instant été détecté sur pommier dans le verger. L'oïdium reste anecdotique.
-Les tordeuses sont présentes sur fruits à noyau mais restent à des niveaux très faibles (tordeuse orientale, anarsia, carpocapse des prunes). Le carpocapse du pommier est présent à des niveaux élevés (20% en moyenne) mais qui restent pour l'instant stables, et sont à mettre en regard de niveaux d'infestation pouvant atteindre 80-100% en l'absence de protection : ce résultat est à confirmer dans la durée.
-La présence d'hoplocampes a été relevée sur pommiers et pruniers mais à des niveaux faibles voire anecdotiques.
-Les forficules ont occasionné des dégâts en fin de période de récolte en 2022. La prophylaxie semble les limiter en 2023.
-La cicadelle verte occasionne sur pêcher des symptômes pouvant affecter l'ensemble de la frondaison en septembre.
-Les punaises sont un ravageur émergent et préoccupant, qui a fortement affecté les dernières variétés de pommes récoltées. Les dégâts de punaises sont plus importants que ceux dus au carpocapse pour ces variétés.
-Après la phase juvénile en pommier, les pucerons n'occasionnent pas de dégâts en 2022-2023, et sont très rapidement régulés sur tous les fruits à noyau.
L'ensemble de ces résultats est à confirmer dans la durée, pour différentes années climatiques et également en regard de la mise en place progressive (ou non) de processus de régulation.
Performance environnementale et utilisation des pesticides
L'IFT total et l'IFT de biocontrôle sont égaux à 0 dans ce dispositif exploratoire '0 phyto'.
Comme indiqué précédemment, le renforcement du service de régulation des ravageurs est effectif, et l'espace de production contribue au maintien de biodiversité fonctionnelle mais également commune via la présence de ressources et d'habitats, et des pratiques peu impactantes.
L'impact environnemental est faible du fait de l'utilisation très faible d'intrants (eau, compost de ferme en valorisation du sous-produit d'un élevage voisin), du peu de mécanisation (broyage herbe, désherbage mécanique sur le rang les premières années), de la combinaison d'opérations (broyage combiné bois de taille et destruction litière foliaire) et de l'utilisation de petits engins (quad électrique) pour limiter le tassement du sol.
En analyse globale (travaux en cours), seule l'utilisation de foncier est un critère noté peu favorable (verger 'extensif') en regard de la production. Ceci illustre toutefois l'absence de référentiel pour évaluer l'ensemble des services écosystémiques soutenus par de tels espaces de production au delà de la production.
Performance agronomique
Rendement moyen par arbre 2023
Données 2023 (gel années précédentes), présentées en kg / arbre du fait de l'hyperdiversification du verger
Les gels de 2021 et 2022 ont fortement perturbé l'entrée en production du dispositif, après des épisodes de neige précoce (novembre 2019) et de grêle massive (juin 2019) ayant affecté l'installation des arbres. Un stress thermique a affecté la production de raisin de table fin août 2023.
L'entrée en production a été échelonnée depuis la production de petits fruits (maintenant en baisse, notamment pour les framboisiers qui sont en fin de vie), les amandiers et les figuiers (2e ou 3e année), jusqu'aux pommiers et fruits à noyau (4e à 6e année selon gel). Les rendements 2023 sont faibles à moyens (cf figure) même si les dégâts sur fruits restent modérés en l'absence de toute protection phytosanitaire (ex. 25% de déchets sur pommiers, espèce la plus impactée).
Ce dispositif met à nouveau en évidence l'absence de référentiel et de méthode pour évaluer les performances de systèmes diversifiés multi-production.
Tous ces résultats sont bien sûr à confirmer dans le temps (culture pérenne) et également parce que les régulations visées peuvent mettre du temps à s'installer (une haie met plus de 10 ans à s'installer), et que diverses perturbations (climat, nouveaux bioagresseurs) peuvent retarder l'acquisition de données ou demander de modifier des aménagements ou des pratiques.
| Dimension évaluée | Type d'indicateurs utilisés | Niveau de satisfaction par rapport aux objectifs | Commentaires |
| Biodiversité | Diversité botanique et diversité d'arthropodes | D'autres groupes sont suivis (oiseaux, chauve-souris, Mammifères) mais le milieu est jeune et l’échelle de suivi plus large que le verger. | |
| Service de régulation des bio-agresseurs | Taux de prédation, taux de parasitisme | Taux élevés dès les premières années. | |
| Utilisation des pesticides | IFT | IFT=0 (et 0 biocontrôle). Cette non-utilisation fait partie du cadre de travail fixé: c'est un prérequis, ce n'est pas un résultat. | |
| Utilisation d'intrants de fertilisation | Quantités de fertilisants |
Pas d'apport exogène de fertilisants (hors compost de ferme fabriqué sur site). |
|
| Utilisation d'intrants d'irrigation | Quantité d'eau |
Utilisation d'eau en protection contre le gel sur fruits à noyau. |
|
| Consommation d'énergie | Temps de machinisme | L'utilisation de matériel électrique (Quad) au lieu de tracteurs pour certaines opérations permet de limiter cette consommation. | |
| Production et qualité de la production | Rendement par catégories | Variable selon les espèces et les années. L'objectif est d'être proche des moyennes régionales en AB. | |
| Charge de travail | Temps de travail et sa répartition |
Travail à l'arbre inchangé. Temps de prophylaxie plus élevé mais compensé par l'absence de traitements et une gestion extensive des couverts du sol. Pas de pics d'activités mais l’activité est répartie tout au long de la saison. La gestion des 1,7 ha correspond à < 0.5 ETP. |
|
| Nature du travail |
Nombre d'espèces cultivées Nombre de passages Temps d'observation et de pilotage |
Travail plus diversifié, apprentissages pour de nouvelles espèces fruitières. Nombre de passages élevé pour la gestion des couverts du sol car broyage max 25% surface. En l'absence de références, un temps de construction de 'repères' spatiaux et techniques est nécessaire. |
Il est complexe de rendre compte des performances d'un verger hyperdiversifié en l'absence de référentiel. Certains critères sont par ailleurs notés 'à améliorer' mais ne constituent pas forcément un point faible du système (ex. 'nature du travail') : des activités plus diversifiées peuvent être au contraire recherchées.
Quatre principes sont importants à prendre en compte pour constituer un assemblage végétal à même de fournir habitat et ressources pour les auxiliaires du verger :
Principe 1. Sélectionner des essences adaptées au sol et au climat.
Une espèce qui pousse mal ou qui est dans un contexte trop éloigné de son optimum ne remplira probablement pas les fonctions attendues.
Principe 2. 'Ne pas nuire' ,c'est-à-dire ne pas sélectionner d'essences hébergeant des ravageurs ou maladies de quarantaine, ou en commun avec le verger et les principales cultures avoisinantes. Les haies constituent des corridors qui peuvent héberger et favoriser la progression d'un pathogène ou d'un ravageur.
Les principaux risques concernent des maladies telles que le feu bactérien (éviter l'aubépine, qui est hôte), la sharka (éviter les Prunus hôtes), l'ECA de l'abricotier (éviter le prunellier épineux si abricotiers à proximité)... ou des ravageurs tels que Drosophila suzukii ou le carpocapse si fruits sensibles à proximité.
Cette réserve est à nuancer en fonction du risque local, des cultures à proximité, et du mode de gestion de ces essences : ex. D. suzukii se développe dans les baies de sureau mais leur consommation rapide par les oiseaux dans le verger circulaire fait que cette essence ne constitue pas un risque pour les fruits du verger.
Principe 3. Sélectionner des essences hébergeant une faune abondante et diversifiée.
Il existe de nombreux guides régionaux et sources d'informations qui indiquent les essences particulièrement riches en auxiliaires. Les essences à feuilles 'poilues' (duveteuses) sont généralement plus riches que celles à feuilles lisses (les 'poils' retiennent des pollens, consommés par des arthropodes détritiphages, qui sont eux-mêmes des proies pour des prédateurs etc.).
Principe 4. Créer une succession de ressources tout au long de la saison (cf schéma).
Les feuillages persistants fournissent un abri d'hivernation. Une association d'essences à floraison précoce (ex. viorne tin, noisetier, cornouiller mâle, romarin...), de saison (sureau, aromatiques en fin d'été etc.) et tardive (ex. Elaegnus, lierre) permet d'offrir des ressources florales tout au long de la saison. L'idée est que plusieurs plantes remplissent une fonction donnée, et que chaque plante fournisse si possible plusieurs fonctions. Une dizaine d'essences permettent généralement d'avoir l'ensemble des fonctions attendues.
Le renforcement de l'abondance et de l'activité des auxiliaires est particulièrement efficace vis-à-vis de ravageurs pouvant être tolérés dans le verger à de niveaux de populations relativement élevés (ex. acariens, psylles, certains pucerons...).
Exemple de l'assemblage végétal implanté dans le cercle extérieur du verger circulaire (ensemble des fonctions attendues : brise-vent, barrière, fourniture d'habitat et ressources pour les auxiliaires).

Il s'agit d'un dispositif en rupture, qui explore des pistes pour repenser les vergers de demain (voire d'après-demain) : ce n'est pas un modèle à transposer en l'état en verger commercial. Par ailleurs, les choix réalisés ne sont pas à prendre tels quels : dit autrement, ce ne sont pas les noms des variétés fruitières ou des essences de la haie qui sont importants, mais les fonctions attendues et les caractéristiques de ces plantes qui permettent de les remplir (ex. un feuillage persistant est une caractéristique intéressante pour fournir un abri d'hivernation aux auxiliaires). De plus, il a fallu faire des choix lorsque plusieurs options étaient possibles, et certains choix ont également été contraints par la disponibilité du matériel végétal (deux ans sont parfois nécessaires pour disposer de certaines variétés sur certains porte-greffes).
Mais la conception, le pilotage et l'évaluation de ce verger ont permis : (i) de rassembler un ensemble de connaissances agroécologiques scientifiques et empiriques pertinentes en arboriculture fruitière (ex. synthèses des Cafés Agro https://ueri.paca.hub.inrae.fr/) ; (ii) d'élaborer des principes de conception pour concevoir de nouveaux types de verger ou d'aménagements pour le verger et (iii) de documenter les aspects opérationnels d'innovations dont certaines sont remobilisables dans un verger 'classique' : constitution d'un assemblage végétal pour favoriser les auxiliaires tout au long de la saison, utilisation de légumineuses pour fertiliser le verger, mise en place d''augmentoriums', association de plantes de service en verger...
L'évaluation en cours permet d'ores et déjà de donner à voir les points d'amélioration et d'attention à considérer lors de la conception d'un verger très diversifié. Pour finir, l'approche développée constitue une des voies possibles ; ce 'modèle low-tech' ne demande pas d'investissements très lourds à la plantation (hors plants et irrigation) et les charges sont très faibles hors main d'oeuvre de conduite des arbres (comme en verger classique). Sa faible productivité les premières années demande le développement d'autres productions sur la ferme ou dans le verger (ex. maraîchage dans les inter-rangs les premières années) et de valoriser au mieux les productions (vente directe, transformation des fruits non vendus en frais).
Plusieurs années sont encore nécessaires pour évaluer dans la durée les limites et les mérites de ce verger et sa résilience :
-Ce verger, planté en 2018 en début de projet, est encore jeune, et l'entrée en production est très récente (en partie du fait des aléas climatiques).
-Nous sommes en culture pérenne, et des résultats pluri-annuels de production sont nécessaires pour assurer la robustesse des résultats.
-Les régulations biologiques visées mettent du temps à se mettre en place, le temps d'installer les plantes ressources pour la biodiversité fonctionnelle (haies, plantes aromatiques). Les résultats actuels soulignent le potentiel de biorégulation de certains bioagresseurs en verger. La résilience à long terme de ce verger reste à évaluer mais il constitue déjà un espace qui contribue à réconcilier production et conservation de la biodiversité.
Comme indiqué précédemment, ce dispositif est exploratoire ; ce n'est pas un modèle à transposer en l'état en tant que verger commercial. Il a permis d'explorer des pistes, d'élaborer des principes de conception pour concevoir de nouveaux types de verger ou d'aménagements pour le verger, et de documenter certains aspects opérationnels de la diversification. Ainsi, des compétences sur un ensemble d'espèces fruitières sont nécessaires, et il n'y a pas ou peu de références pour le pilotage de systèmes très diversifiés qui reposent sur de nombreuses interactions entre espèces. Le travail dans le verger s'accompagne d'une plus grande diversité d'activités, et de plus de temps d'observation ; en revanche, il n'y a pas de pics d'activités du fait de leur échelonnement permis par la diversification.
Des travaux complémentaires sont à poursuivre : suivi des régulations en phase de maturité du verger, analyses technico-économiques pluri-annuelles, capitalisation sur les apprentissages et le mode de gestion d'espaces de production diversifiés etc. Les suivis réalisés sont prévus jusqu'en 2030. L'analyse des marges de manoeuvre pour faire évoluer à la fois les vergers 'classiques' et ce type de verger très diversifié vers un compromis réconciliant production et haut niveau de régulation est également à considérer.
![Livret ALTO Gotheron_2020 web [Français]](/sites/default/files/styles/260x205/public/2020-12/altoss.png?itok=dWmi4P56)