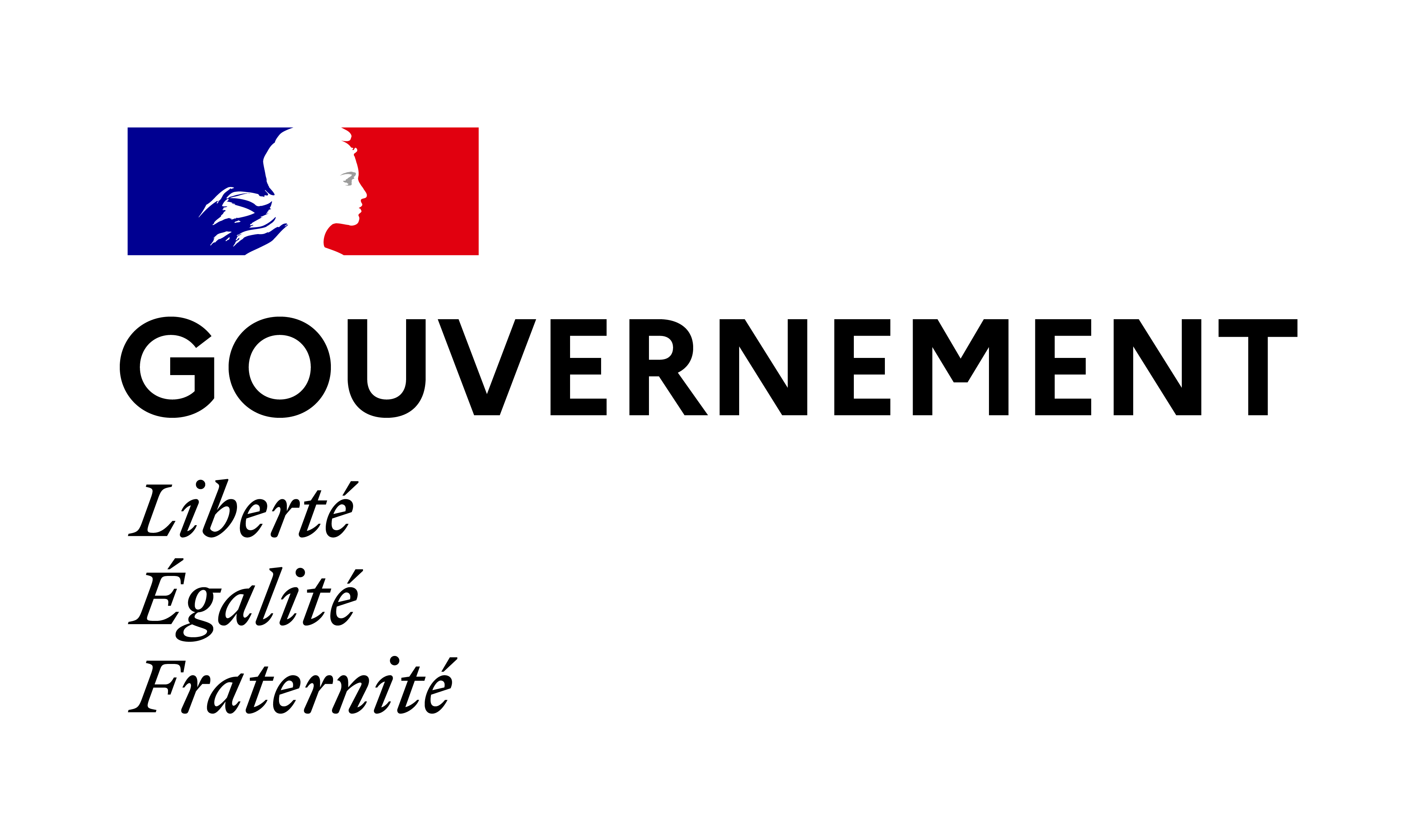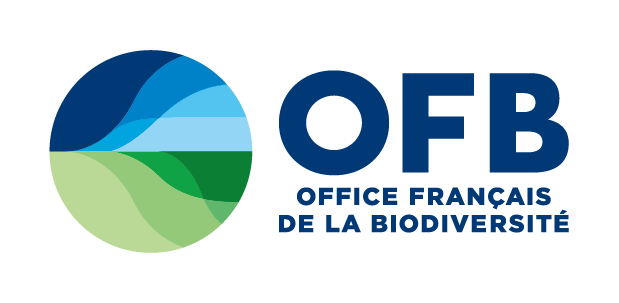Site CATE - BREIZHECOLEG

La Bretagne, principal bassin producteur de légumes en France (19 % de la production nationale), s’est investie pleinement dans les valeurs du plan ECOPHYTO depuis sa mise en place.
La station expérimentale du CATE (Comité d’Action Technique et Economique) est située à Saint-Pol-de-Léon (29),(48.658417, -3.986877). Implantée au cœur de l’une des zones légumière et horticole de Bretagne, la station expérimentale de Vézendoquet conduit des programmes régionaux et nationaux d’expérimentation visant à résoudre les problèmes technico-économiques rencontrés en production, à répondre aux évolutions de la consommation ou réglementaires.
Au sein du réseau expérimental régional, le CATE est le site pilote de l’expérimentation en légumes de plein champ et en serre verre en conventionnel. La station expérimentale conduit également des essais en horticulture ornementale et en champignons cultivés. L’équipe compte 22 personnes, dont 7 ingénieurs. Le programme plein champ se compose de 6,7 ETP. La station dispose de 16 hectares, dont 12 hectares consacrés aux essais de plein champ et 1 hectare de serre verre et abris plastiques. Elle est également équipée d’un ensemble de 16 cases lysimétriques et de cellules climatisées pour la réalisation d’essais de conservation post-récolte.
L’ambition du projet DEPHY Expé BREIZHECOLEG est de confirmer les bons résultats obtenus dans le projet DEPHY EXPE BREIZLEG (2012-2017) pour des systèmes conventionnels et biologiques, de poursuivre sur des systèmes culturaux différents et surtout d’intensifier la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour tendre vers des systèmes agroécologiques.
| Climat | Sol |
|
Climat océanique Pluviométrie moyenne (1967 - 2018) : 887 mm T°moyenne (1967 - 2011) : 11,1°C (données du CATE) |
Limons éoliens profonds - Lehm (20 % sable, 10 % d'argile, 70 % de limon) Ph : 7,0 Taux de Matière Organique : 2.8 % |
| Niveaux de pression : Maladies | Niveaux de pression : Ravageurs | Niveaux de pression : Adventices |
 |
 |
 |
Maladies :
Le climat du bassin est favorable au développement du Mycosphaerella sur chou-fleur d'hiver, du mildiou de l'artichaut et de l'échalote. Ces maladies sont présentes chaque année et sont nuisibles pour les cultures. En raison du choix variétal sur salade (résistances génétiques au mildiou), les ennemis de la culture sont majoritairement l'oïdium, le Sclérotinia et le Tip burn.
Les autres maladies dépendent des conditions climatiques.
Ravageurs :
Les problèmes les plus fréquents et nuisibles économiquement sont liés aux gros ravageurs (lapins, lièvres, oiseaux...) et nécessitent l'utilisation de filets de protection et/ou d'effaroucheurs.
Sur artichauts, les pucerons verts et noirs peuvent devenir problématiques en cas de fortes attaques et dépendent de la population d'auxiliaires.
La salade de 4ème gamme est une culture à forte exigence qualitative. De part l'interdiction des néonicotinoïdes, les ravageurs sur salades sont les pucerons, chenilles et les limaces.
Sur choux, le risque chenilles dépend de la période de production. Il est important en été et début d'automne (notamment dans les inflorescences). À l'inverse, elles ne sont pas problématiques pour la production hivernale. Le risque pucerons sur choux dépend également de la période de production, de la présence d'auxiliaires et de la pluviométrie.
On note à l'échelle du bassin, une forte pression de mouche du chou chaque année.
La présence de thrips est rare sur échalote.
Adventices :
La majeure partie des cultures, comme le choux et l'artichaut, sont des plantes sarclées et font l'objet de binages et de buttages traditionnels.
Il peut y avoir notamment dans le cas d'années humides des difficultés à maîtriser la propreté des parcelles. Dans ce cas, des interventions manuelles sont réalisées (binettes) et affectent les temps de travaux.
L'échalote est plantée sur du paillage. Seules les inter-planches font l'objet d'un contrôle des adventices.
Dans la région, les légumes les plus cultivés sont :
- La famille des choux, comprenant le chou-fleur, le brocoli, le chou pommé, les choux-fleurs de couleur (Romanesco, vert, orange et violet). Le chou-fleur est l’espèce la plus importante et la région représente 82 % de la production nationale ;
- Les artichauts avec notamment le Camus de Bretagne, le Castel et le petit violet, avec 79 % de la production nationale ;
- L’échalote de tradition avec près de 80 % de la production nationale ;
- La laitue composée de différentes variétés: batavia, laitue, iceberg, mâche et jeunes pousses représente 19 000 tonnes/an (9 % production nationale).
Dans un contexte économique fragile (aléas climatiques, fluctuations de prix sur les marchés, distorsion de concurrence avec d’autres bassins européens), la durabilité économique de la filière doit faire face à une diminution des solutions disponibles en matière de protection des cultures et également à une augmentation des cahiers des charges promouvant l’image propre et la valeur santé des légumes, avec des normes très restrictives. D’autre part, l’image terroir est également importante économiquement avec le coco de Paimpol et l’oignon rosé de Roscoff, productions sous AOP.
La station expérimentale se situe en plein cœur de la zone de production située sur le littoral nord breton. Le processus de production de légumes s’inscrit dans un contexte environnemental faisant cohabiter des activités maritimes et également touristiques.
De plus, le bassin breton est doté d’un réseau hydrographique très dense, d’environ 30 000 km. Le sous-sol breton favorise en effet le ruissellement de l’eau en surface. Ainsi, à l’inverse du reste du territoire national, en moyenne, environ 80 % de l’alimentation en eau potable en Bretagne est assurée par les eaux superficielles.
|
Système ultra bas intrant (- 75 % IFT) |
Système bas intrant (- 50 % IFT) |
Système de référence |
|
|
|

|
 |

|
Dispositif expérimental
|
|
Le système conventionnel raisonné constitue le système de référence. Le dispositif est composé d’une répétition temporelle (A et B), décalée de 2 années afin de limiter l’effet « année ». Chaque système de culture est donc mis en place sur 0,13 ha (2 répétions de 650 m²). L’expérimentation représente environ 0,40 ha chaque année sur ce site. 2 à 3 cultures légumières seront implantées par an sur les 3 systèmes de culture testés à la station du Caté. Au total, à l’échelle des 6 années du projet, 66 itinéraires culturaux seront évalués en agriculture conventionnelle. Le matériel végétal utilisé est homogène (hybride F1 ou population fixée). |
Les expérimentations sont réalisées dans le cadre habituel de la conduite des expérimentations régionales. Les observations et mesures seront réalisées en tenant compte des méthodologies d’observation et de mesures de précédents programmes d’expérimentation (programme BREIZLEG, VIGISPORES, action FAM EcoVarLeg, PerformVarlég, essais BPE…). Les observations et mesures seront formalisées et mises en commun avec l'autre site expérimental.
Les observations sont réalisées sur 5 répétitions de la mesure afin d’assurer la robustesse des résultats (mesures sur 5 x 80 m² pour les cultures de choux et d’artichaut, sur 5 x 60 plantes pour la salade et 5 x 100 touffes pour l’échalote).
Ces observations et mesures comprennent :
- Les mesures des rendements, réalisées en conformité avec les cahiers des charges en vigueur à l’AOP Cerafel (marque : Prince de Bretagne),
- La faisabilité de mise en œuvre des RdD (satisfaction des pilotes de chaque site par rapport à la mise en place de la RdD et possibilité de leur mise en œuvre…),
- Des notations sur la présence des bioagresseurs et des auxiliaires propres à chaque culture suivant les stades critiques,
- L’enregistrement des itinéraires techniques de chaque parcelle (toutes les interventions mécaniques ou manuelles avec caractérisation des outils, des intrants et également des temps de travaux).
Ce site expérimental, tout comme l'autre, est équipé de stations météorologiques permettant de caractériser le climat annuel.
Les données seront ensuite saisies annuellement sur la plateforme informatique Agrosyst.
Afin de comparer les performances des systèmes entre eux, les observations et mesures doivent permettre d’établir les indicateurs suivants:
- Indicateurs agronomiques : Rendements, % commercialisé, qualité des produits, respect du cahier des charges, satisfaction du pilote, faisabilité technique, gestion des bioagresseurs (absences de dommages ou pertes de récoltes), ...
- Indicateurs économiques : Marge brute, marge semi-nette, impact économique du levier testé (coût de mise en œuvre…), …
- Indicateurs sociaux : Temps de travaux, nombre de passages à la parcelle (hors plantation et récolte), toxicité, pénibilité, …
- Indicateurs environnementaux : IFT, IFTsa (potentiel de transfert des matières actives (vertical et horizontal)), consommation de carburant et GES, impact sur la faune auxiliaire, …
Des experts seront associés à ces évaluations (Bureau d’études économiques Cerfrance, conseillers prévention MSA, Service environnement qualité des OP, …).
Le parcellaire du Caté consiste en 16 hectares, dont 12 hectares labourables en un seul tenant. Ce parcellaire est entouré par des haies de natures et de compositions floristiques diverses.
L’essentiel de la périphérie du parcellaire est constitué de talus portant une végétation herbacée, arbustive ou arborée. Les herbacées comportent surtout des graminées mais également la fougère aigle et le silène dioïque.
On note également diverses espèces arbustives (ajonc, aubépine, prunellier, orme, noisetier) et des arbres bien développés (chêne, châtaigner et érable sycomore).


La parole de l'expérimentateur :
BREIZHECOLEG teste des leviers avec une dimension agroécologique forte et une utilisation de produits phytosanitaires en ultime recours. En début du projet, des ateliers de co-conception ont été réalisés avec les experts des cultures légumières. Pour chaque culture, les objectifs à atteindre ont été fixés. La liste des verrous (bioagresseurs, …) et les leviers à intégrer ont été identifiés et priorisés de manière collective de façon à pouvoir être transférés chez les agriculteurs. Ce travail a permis de rédiger des règles de décisions. Ces dernières seront revues chaque année afin d’être en lien avec l’actualité réglementaire. Les leviers mobilisés ont par ailleurs été évalués dans des essais analytiques sur la station expérimentale. Par rapport à BREIZLEG (2011-2017), la salade de 4ème gamme a été incluse dans le nouveau projet. La reconception est nécessaire pour cette culture qui fait face à une forte diminution des solutions phytosanitaires autorisées. Dans le cadre de ce programme, la durabilité globale des conduites testées sera évaluée en fin de projet sur les piliers économiques, environnementaux et sociétaux.