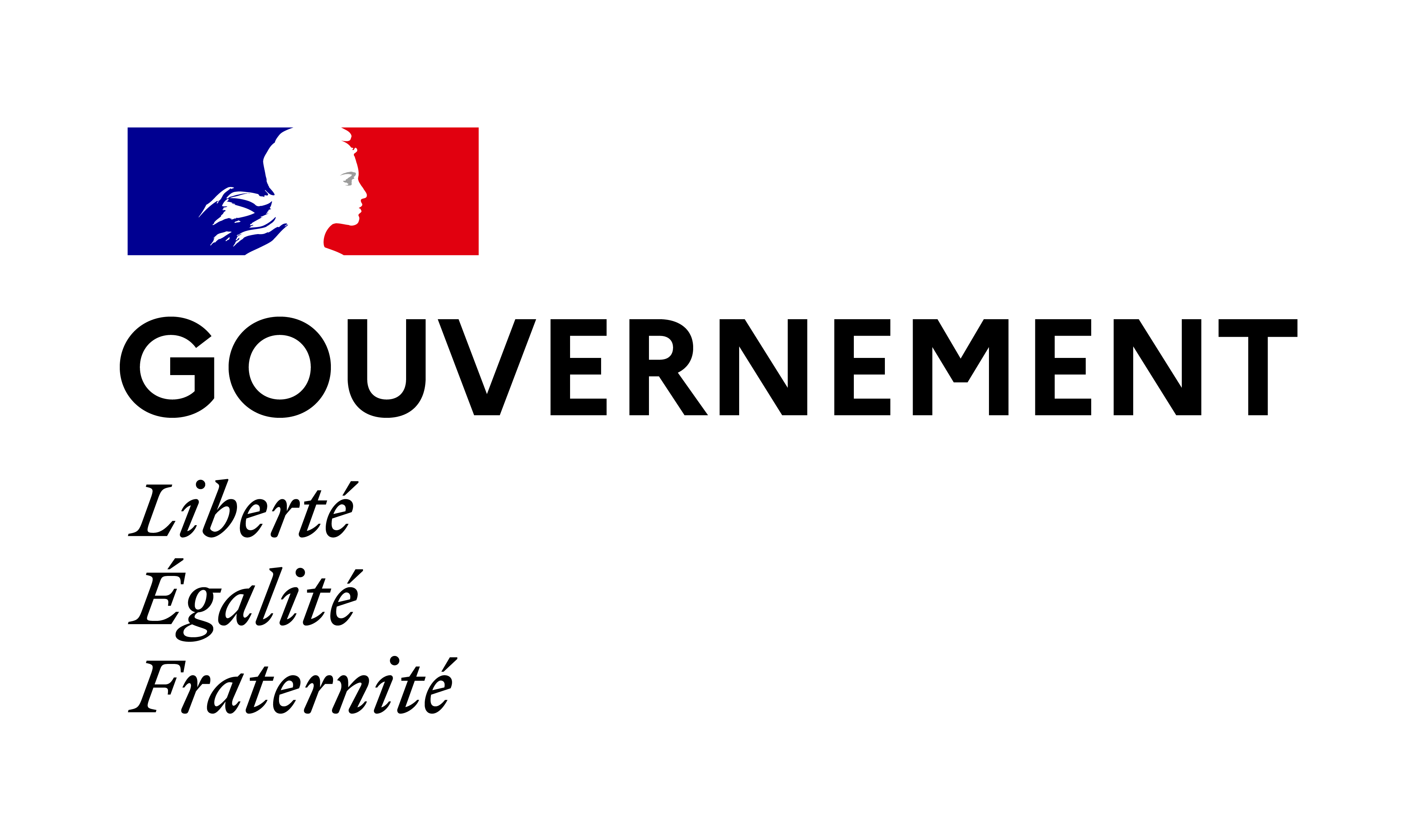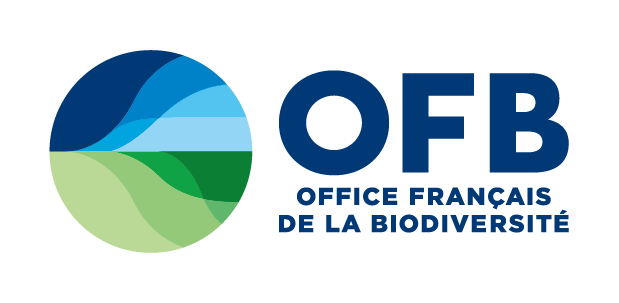Site Terre d'Essais - BREIZHECOLEG

La station Terre d’Essais (48.803823, -3.150399) est située au cœur du bassin de production légumier des Côtes d’Armor à Pleumeur-Gautier. Spécialisée en Agriculture biologique (AB) depuis 1998, elle est le site pilote de l’expérimentation légumière régionale en AB. Par ses travaux de recherche et d’expérimentation, Terre d’Essais participe au maintien et au développement du tissu agricole légumier breton.
Les expérimentations menées répondent à trois objectifs : 1) L’amélioration de la compétitivité et de la durabilité des systèmes de productions légumiers ; 2) Le maintien et l’amélioration de la qualité des produits ; 3) La réduction de l’impact environnemental des productions. La station dispose de 10 ha de plein champ (AB) et de 3 800 m² de serre multichapelle (dont 1 740 m² en AB). Elle emploie une équipe de 8 personnes composée d’ingénieurs, de techniciens et de personnel administratif.
L'ambition du projet BREIZHECOLEG pour le mode de production biologique est de rendre les systèmes les plus attractifs possibles d’un point de vue économique (réduction des coûts de production) et social (réduction des temps de travaux, de la pénibilité…) dans le but d’une généralisation de ces systèmes déjà à très bas intrants.
| Climat | Sol |
| Climat océanique Précipitation moyenne annuelle : 850 mm |
Sol Limono sablo-argileux profond : (Argile 12,8 % - Limon fin 15.2 % - Limon grossier 48 % - Sable fin 17.9 % - sable grossier 26 %) Taux de matière organique = 2.5% |
| Niveaux de pression : Maladies | Niveaux de pression : Ravageurs | Niveaux de pression : Adventices |

|

|

|
Les principales maladies touchent les choux (Alternaria, Mycosphaerella et hernie) et l’échalote. Dans le contexte de la station, la pression maladie en salade est très faible (Sclerotinia et mildiou).
Les oiseaux déprédateurs (pigeons, choucas et corneilles) sont les ravageurs exerçant la plus forte pression sur le système. Leur polyphagie, l’absence de moyens de contrôle durables dans le temps et d’actions de régulation efficaces à l’échelle du bassin de production expliquent cette forte pression. Le taupin et les chenilles phytophages (piérides et noctuelles) exercent une pression modérée. Les dégâts de limaces, de pucerons et de lièvres sont plus occasionnels.
Dans les systèmes légumiers AB de la station, 5 adventices exercent une forte pression : l’ortie, le chénopode, le paturin, le mouron et la spergule.
Dans la région, les légumes les plus cultivés sont :
- La famille des choux, comprenant le chou-fleur, le brocoli, le chou pommé, les choux-fleurs de couleur (Romanesco, vert, orange et violet). Le chou-fleur est l’espèce la plus importante et la région représente 82 % de la production nationale ;
- Les artichauts avec notamment le Camus de Bretagne, le Castel et le petit violet, avec 79 % de la production nationale ;
- L’échalote de tradition avec près de 80 % de la production nationale ;
- La laitue composée de différentes variétés : batavia, laitue, iceberg, mâche et jeunes pousses représente 19 000 tonnes/an (9 % de la production nationale).
Dans un contexte économique fragile (aléas climatiques, fluctuations de prix sur les marchés, distorsions de concurrence avec d’autres bassins européens), la durabilité économique de la filière doit faire face à une diminution des solutions disponibles en matière de protection des cultures et également à une augmentation des cahiers des charges promouvant l’image propre et la valeur santé des légumes, avec des normes très restrictives. D’autre part, l’image terroir est également importante économiquement avec le coco de Paimpol et l’oignon rosé de Roscoff, productions sous AOP.
La station expérimentale se situe en plein cœur de la zone de production située sur le littoral nord breton. Le processus de production de légumes s’inscrit dans un contexte environnemental faisant cohabiter des activités maritimes et également touristiques.
De plus, le bassin breton est doté d’un réseau hydrographique très dense, d’environ 30 000 km. Le sous-sol breton favorise en effet le ruissellement de l’eau en surface. Ainsi, à l’inverse du reste du territoire national, en moyenne, environ 80% de l’alimentation en eau potable en Bretagne est assurée par les eaux superficielles.
|
Système AB innovant (Réduction des coûts de production, temps de travaux, pénibilité) |
Système AB de référence |
|
|

|

|
Dispositif expérimental

|
Description du dispositif expérimental : Le dispositif expérimental s’étend sur 0.25 ha. Chaque système est répété une fois dans le temps : répétition A et répétition B. Deux systèmes sont évalués sur ce site : AB de référence et AB innovant. Il y a donc 4 systèmes en cours d’évaluation. Ils occupent chacun une parcelle de 528 m². Les différentes mesures et observations sont répétées 4 fois au sein de ces parcelles. |
Les expérimentations sont réalisées dans le cadre habituel de la conduite des expérimentations régionales. Les observations et mesures seront réalisées en tenant compte des méthodologies d’observation et de mesures de précédents programmes d’expérimentation (programme BREIZLEG, VIGISPORES, action FAM ECOVARLEG…). Les observations et mesures seront formalisées en début du projet entre les 2 sites.
Ces observations et mesures comprennent :
- Les mesures des rendements, réalisées en conformité avec les cahiers des charges en vigueur à l’AOP Cerafel (marque : Prince de Bretagne),
- La faisabilité de mise en œuvre des Règle de Décision (RdD) : satisfaction des pilotes de chaque site par rapport à la mise en place de la RdD et possibilité de leur mise en œuvre… ;
- Des notations sur la présence des bioagresseurs et des auxiliaires propres à chaque culture suivant les stades critiques ;
- L’enregistrement des itinéraires techniques de chaque parcelle (toutes les interventions mécaniques ou manuelles avec caractérisation des outils, des intrants et également des temps de travaux).
Le site d’expérimentation est équipé d'une station météorologique permettant de caractériser le climat annuel.
Les données seront ensuite saisies annuellement sur la plateforme informatique Agrosyst.
Afin de comparer les performances des systèmes, les observations et mesures doivent permettre d’établir les indicateurs suivants :
- Indicateurs agronomiques : Rendements, % commercialisé, qualité des produits, respect du cahier des charges, satisfaction du pilote, faisabilité technique, gestion des bioagresseurs (absences de dommages ou pertes de récoltes)... ;
- Indicateurs économiques : Marge brute, marge semi-nette, impact économique du levier testé (coût de mise en œuvre …)… ;
- Indicateurs sociaux : Temps de travaux, nombre de passages à la parcelle (hors plantation et récolte), toxicité, pénibilité … ;
- Indicateurs environnementaux : IFT, IFTsa (potentiel de transfert des matières actives (vertical et horizontal)), consommation de carburant et Gaz à Effet de Serre (GES), impact sur la faune auxiliaire…
Des experts seront associés à ces évaluations (bureau d’études économiques Cerfrance, conseillers prévention MSA, service environnement qualité des OP …).
La zone légumière est située dans une région bocagère avec un maillage de haie relativement dense (50 à 75 m de haie par ha cultivé selon l’observatoire de l’environnement en Bretagne). Ainsi la parcelle jouxte une haie arbustive de feuillus et de conifère.
Parmi les éléments paysagers remarquables il y a la présence de bâtit ancien (corps de fermes, églises, maison de ville) et de logement neufs à proximité du site d’expérimentation.
Enfin la parcelle expérimentale à la particularité de se situer sur une presque île, la mer étant à 4km à l’est et à l’ouest et 6.5 au nord.
La parole de l'expérimentateur :
Le projet BREIZHECOLEG nous a permis de :
- Réunir tous les acteurs techniques de la filière pour définir les RdD régissant la conduite technique des principales cultures légumière ;
- Engager des réflexions pour construire de nouvelles règles aboutissant à une réduction drastique de l’utilisation de produits phytosanitaires ;
- Prouver ces règles sur le terrain sur les différents sites expérimentaux.
Ce travail nous permet de créer et partager un savoir précieux pour la filière. Grace à ce socle commun, les marges de progrès sont désormais plus visibles et partagées. Le progrès permis par ces informations ne concerne pas uniquement la réduction d’utilisation de produits phytosanitaires, elles pourront également être utilisées pour inciter à la transition vers l’AB, réduire la pénibilité et améliorer les performances agronomiques et technico-économiques des systèmes de culture. Enfin pour les nouveaux arrivants dans la filière, le savoir généré par le projet BREIZHECOLEG leur permettra d’accélérer leur montée en compétence technique.