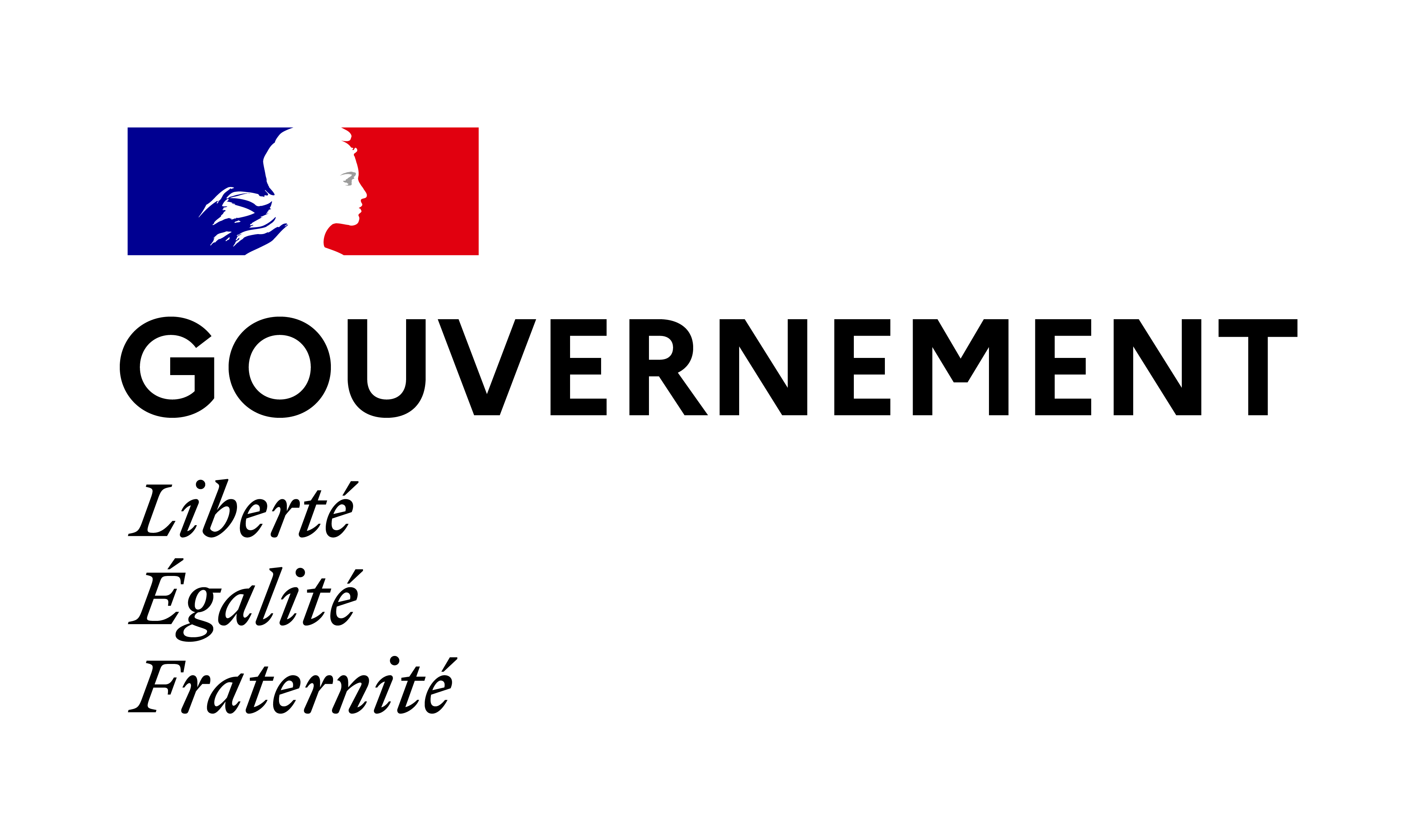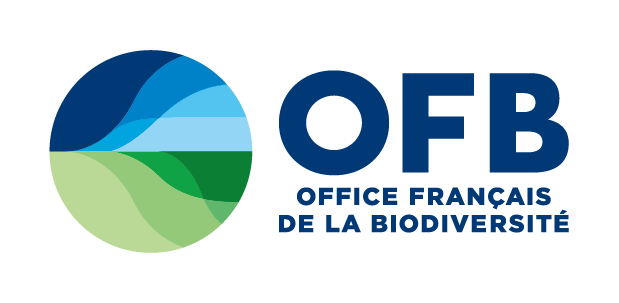Système biologique - Kerguéhennec SYNO'PHYT

Conception du système
Le système Agriculture Biologique a été mis en place en 2013 dans le cadre du projet DEPHY EXPE SGC Bretagne. Il a été réactualisé à l’occasion de l’atelier de co-conception organisé en 2018 dans le cadre du projet Syno’phyt. Cet atelier a rassemblé 34 participants d’horizons variés : Chambre d’Agriculture de Bretagne, instituts techniques, agriculteurs, coopérative agricole (Triskalia), Recherche agronomique (INRA) et enseignement supérieur agronomique (ESA), associations de filière (IBB) et organismes de développement (FDCeta 35).
L’objectif de l’atelier était de concevoir deux prototypes. Les participants ont travaillé en sous-groupes de 5 à 6 personnes, à l’aide du jeu Mission Ecophyt’eau, un outil ludique et participatif destiné à faciliter les échanges autour de la conception d’un système de culture.
Le cadre de cet atelier, présenté en début de journée, était le suivant :
• Présentation des leviers et performances du SdC AB en place de 2013 à 2018
• Les systèmes de culture proposés devaient être représentatifs d’exploitations spécialisées en grandes cultures, ou comportant un atelier volaille.
• Afin que le projet soit complémentaire des autres projets DEPHY EXPE bretons, les rotations ne devaient comporter ni cultures fourragères ni légumes.
• Le choix des cultures devait se faire en lien avec les besoins de la filière (présentés par la coopérative partenaire du projet) : les cultures devaient être prioritairement destinées à l’alimentation animale, avec une recherche d’un gain en autonomie protéique.
• La fertilisation organique devait être représentative d’une exploitation en production volaille AB
Mots clés :
reconception de systèmes - autonomie azotée de la rotation - rotation longue
Caractéristiques du système

|
Interculture : Couverts longs (45% avoine diploïde, 43% tournesol, 12% phacélie) et courts (50% moutarde blanche, 50 % d’avoine entre la féverole et l’avoine de floconnerie). Fertilisation : Fientes de volailles apportées sur maïs uniquement (1 apport sur 5 ans). Travail du sol : Labour systématique en lien avec de précédents essais sur le travail du sol et la gestion des adventices. Infrastructures agro-écologiques : Les parcelles sont entourées de haies bocagères et de bois. |

|
|
Agronomiques |
|
| Environnementaux |
|
|
Maîtrise des bioagresseurs |
|
|
Socio-économiques |
|
Le mot de l'expérimentateur
Ce système combine les bénéfices de l'alternance des cultures de printemps/été et d'automne en utilisant des cultures à destination de l'alimentation animal et humaine (avoine de floconerie et sarrasin). La diversification apporte de nombreux bénéfices, notamment la présence d'une flore adventice variée (en opposition à une flore spécialisée concurrentielle) et la dilution du risque d'accident de culture. Cependant, ces cultures reposent sur des marchés de niche et leur pérennité est donc dépendante des collecteurs (cas de l'avoine valorisée en fourrage 2 années sur 6).
La principale difficulté réside dans la gestion du chardon : actuellement présent sur le dispositif, sa présence est très variable selon l'année (effet direct mais aussi selon les conditions d'interventions en été) et l'effet sur le rendement est variable selon les cultures. La présence d'une pérenne (luzernière ou prairie) est la technique la plus efficace pour ralentir/repousser le phénomène, mais la viabilité du système repose alors sur la valorisation économique de cette luzerne. Une partie de l'essai a donc été basculé en luzerne afin de mesurer les arrières-effets (adventice et fertilité) et les résultats économiques.
La fertilité du sol est aussi sous surveillance : l'unique apport de déjections de volailles en 5 ans équilibre les bilans P et K, mais les simulations réalisées pointent des risques de diminution du taux de matière organique. Des mesures régulières sont donc pratiquées (analyses biologiques, observations de structure, ...).
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.


Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs


Gestion des adventices
|
Féverole |
Avoine |
Maïs |
Triticale-pois |
Sarrasin |
||||||
|
Adventices (annuelles) |
Adventices (vivaces) |
Adventices (annuelles) |
Adventices (vivaces) |
Adventices (annuelles) |
Adventices (vivaces) |
Adventices (annuelles) |
Adventices (vivaces) |
Adventices (annuelles) |
Adventices (vivaces) |
|
|
2019 |
||||||||||
|
2020 |
||||||||||
|
2021 |
||||||||||
|
2022 |
||||||||||
|
2023 |
||||||||||
En 2021, les niveaux de satisfaction pour la féverole et le sarrasin sont faibles alors que celui de l'avoine est bon :
Le semis du sarrasin s’est fait en conditions relativement sèche au démarrage, ce qui se traduit par un taux de levée de 57 %. Par la suite, le développement de la culture a été lent (manque de luminosité, de température ?), ce qui a été aussi observé sur des parcelles de producteurs suivies dans la région. En conséquence, la couverture du sol n’était pas au rendez-vous : la pression adventice forte s’est exprimée (chénopodes, renouées).
La féverole, semée plus tôt (mars), a bénéficié de meilleures conditions de démarrage. Cependant, les conditions lors de la montaison ont été proches de celles précisées pour le sarrasin : sec et froid, suivies de pluies en juin, empêchant le hersage. Ce temps, peu « poussant », est favorable à l’efficacité des passages de herse étrille, mais repousse la date de couverture de sol.
L’avoine a été semée dans de bonnes conditions, avec un taux de levée de 96 %. La pression adventices (annuelles) reste forte mais les conditions d’interventions de désherbage mécanique ont été favorables : l’efficacité de ces passages, 3 au total (ce qui correspond à la moyenne pluri-annuelle) était satisfaisante.
A l'échelle du système, le chardon est régulièrement présent sur les parcelles, avec des variations annuelles, expliquant l'insatisfaction sur cet indicateur. Le chardon s'est développé à partir des bords de parcelles et a gagné progressivement les parcelles. Les itinéraires ont été modifiés afin de réguler ce développement : passages d'outils (pattes d'oie pour scalper, épuiser et remonter à la surface les plantes). Ces interventions ont lieu après la récolte de l'avoine et du triticale-pois et elles sont très dépendantes des conditions météo : leur efficacité est donc variable selon les années.
Gestion des maladies
|
Féverole |
Avoine |
Maïs |
Triticale-pois |
Sarrasin |
|
|
2019 |
|||||
|
2020 |
|||||
|
2021 |
|||||
|
2022 |
|||||
|
2023 |
La féverole et l'avoine ont été particulièrement marquées par la présence de maladie en 2020, avec une même cause : le manque de variété disponible. Pour la féverole, c'est la variété Bioro qui a été semée par manque de disponibilité de Tiffany. Or cette variété, plutôt orientée pour les couverts, est très sensible à la rouille et au botrytis. Pour l'avoine, le manque de la variété Vodka à conduit à mettre une variété alternative sensible à la rouille couronnée.
Gestion des ravageurs
|
Féverole |
Avoine |
Maïs |
Triticale-pois |
Sarrasin |
|
|
2019 |
|
||||
|
2020 |
|
||||
|
2021 |
|
||||
|
2022 |
|
||||
|
2023 |
|
Rendement
Les objectifs ont été définis au démarrage de l’essai en 2013, avec plusieurs approches selon les cultures :
- Cas d’une culture déjà produite en amont de l’essai : céréale pure (3 fois/10 ans), triticale dans la première rotation (2013-2018) puis avoine (2019-2023)
à Prise en compte du potentiel de sol, pas de fertilisation et historique
- Cas d’une culture déjà produite mais peu fréquente : maïs
à Fertilisation et correction dans le temps : 60 puis 70 q/ha (2017)
- Cas d’une culture non réalisée sur l'îlot : féverole pure
à Observatoire régional, RU/climat
Lors de la révision de la rotation en 2018, l’ensemble des cultures (sauf l’avoine) avaient été produites chacune 6 fois, permettant de confronter les objectifs aux données réalisées.
(en rouge : objectifs de rendement et IFT non atteint ; en vert : objectif de rendement et IFT atteint)
Avoine : objectifs de rendement atteint 3 années/4, mais non atteinte des objectifs qualitatif (PS) 3 année/4 (voir performances économiques plus bas). La variété disponible en 2020 n’était pas celle souhaitée et elle s’est avérée très sensible à la rouille couronnée.
Maïs : seule culture fertilisée, sa réussite est liée à la bonne maîtrise de l’enherbement sur le rang et donc des conditions météos influençant l’efficacité des passages de herse étrille et la vigueur au démarrage du maïs. L’objectif est atteint 3 année /4.
Sarrasin : les résultats de cette culture sont aléatoires, avec deux années de résultats médiocres (0 et 3 q/ha) à cause des conditions météos (germination sur pieds notamment). La sensibilité de cette culture aux aléas climatiques est forte.
Féverole : atteinte des objectifs 3 années/4, avec un manque de disponibilité de la variété souhaitée en 2020 se traduisant par le semis d’une variété très sensible au botrytis et peu couvrante.
Triticale-pois : seulement une année satisfaisante. Sans être médiocre, les résultats se sont dégradés au fur et à mesure des années (association présente depuis 2013). Dans la rotation, cette culture ne bénéficie pas des arrières-effets d’une légumineuse (cas de l’avoine) mais seulement d’éventuels reports liés à la fertilisation du maïs précédent. OR ce dernier valorise bien l’azote apporté par ses rendements corrects.
Marge directe moyenne (en €/ha, 2019-2022)
Cette MD a été calculé de la façon suivante :
- Marge directe = chiffre d’affaire (t x euros) + aides couplées et découplées – charges intrants – charges méca
- Charges méca = Frais Financier moyen long terme (€/ha) + Amortissement (€/ha) + Entretien / Location (€/ha) + Carburant (€/ha)
- Prix de vente fixé entre les 4 années (moyenne France Agrimer des prix constatés entre 2012-2018)
Nous avons fixés le prix de vente des cultures afin de mesurer la variabilité de notre SdC entre les années (effet climat) (nous avons cependant exploré des scenarios de variations du contexte économique afin de mesurer la robustesse du SdC).

Evolution des postes constituants la marge directe (en €/ha, 2019-2022)
Les charges de mécanisation sont de 286 €/ha, liées à de faible coût d’épandage (seulement 1 année/5, afin d’être représentatif de la rareté de la ressource). Ce faible coût compense partiellement la présence d’un labour annuel.
Le coût d’intrant est stable selon les années, constitué par l’achat de semences (en complément des semences produites sur l’exploitation, à un prix équivalent au prix de vente sur le marché). Les proportions de semences certifiées sont variables selon les cultures (ex : 50% de la féverole est achetée, 100% du sarrasin dans le cadre d’un contrat).
2 facteurs expliquent les faibles marges de certaines années (notamment 1 et 4) :
- La valorisation en alimentation humaine de l’avoine uniquement 1 année/4. En effet, un seuil de PS (>50) est exigé pour la valorisation, faute de quoi l’avoine est déclassée en alimentation humaine à 170 €/t. Les trois années où l’avoine a été déclassée, le PS variait de 47 à 49. Ce résultat est relativement aléatoire, l’agriculteur n’ayant pas de levier pour gérer ce composante (effet météo).
- La destruction de certaines cultures, en lien avec la faible disponibilité de semence. En effet, le choix des variétés disponibles chez les fournisseurs locaux reste limité, notamment pour les espèces « mineures ». Ainsi, les années où les variétés demandés n’étaient pas disponibles, les variétés de remplacement ont été très touchées par la maladie (cas de l’avoine en 2020 touchée par la rouille couronnée (14 q/ha)) ou de la féverole en 2020, broyée).
- Le mauvais résultat d’une culture à cause de la météo : cas du sarrasin, germé sur pied en 2019 ou floraison échelonnée en 2022 (respectivement 0 et 3 q/ha).
En 2021, toute les cultures ont été récoltées et l’avoine valorisée en alimentation humaine.

Temps moyen (en h/ha, 2019-2022) et par poste (à l’échelle d’une exploitation de 100 ha)
Le poste le plus consommateur en temps est le "travail du sol". Le labour pratiqué avant chaque culture, mais aussi les faux-semis en amont du maïs et du sarrasin expliquent cette valeur.
La valeur du poste "semis" est élevée aussi, avec le semis au combiné herse rotative + semoir de 4 des 5 cultures, auxquels viennent s’ajouter le temps de semis des couvert : 4 couverts en 5 ans (couverts courts et longs).
Le temps passé au désherbage mécanique s’explique par les passages de herse étrille sur les céréales et la féverole (3/an en moyenne), assez peu consommateur en temps (20 min/ha) et par le binage du maïs (2/an en moyenne).
Le poste "fertilisation" est particulièrement faible : un seul épandage à l’échelle de la rotation de déjections de volailles.


La répartition du temps au champs (en h/ha) est représenté dans le graphique suivant :
Le travail est réparti tout au long de l'année, avec des pics :
- en mars : préparation des terres pour les cultures de printemps (labour) et hersage des cultures d'autonme
- en juillet : récoltes des cultures d'automne et binages
- en septembre : récolte de la féverole, semis des couverts court et longs
- en novembre : récolte du maïs et préparation des terres et semis des cultures d'automne
La multiperformance du système est exprimée ici par rapport à un système moyen breton. Ce système moyen est un système fictif qui représente les pratiques moyennes des agriculteurs bretons sur une rotation maïs blé. Il a été reconstitué à partir des bases de données disponibles (base nationale des ventes de produits phytosanitaires) et à dires d’experts. Les rendements utilisés sont les rendements moyens réalisés sur les parcelles hors essais de la station expérimentale de Kerguéhennec.
La marge directe moyenne est équivalente à celle du SdC de référence.
Les performance environnementales sont améliorées dans ce système au regard des indicateurs de diversité des cultures, de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires (-100%) et d'émissions de GES (-71%).
L'efficience économique des intrants, qui traduit l’efficience technique avec laquelle les intrants sont transformés par le système de culture, est également améliorée de 24%.
Le rendement énergétique est dégradé de 35%: il s'agit de la production d'énergie brute (en MJ/ha) sur la consommation d'énergie primaire totale (en MJ/ha également). La consommation d’énergie primaire est liée à la consommation de carburant nécessaire pour conduire le système de culture, ainsi que l’ensemble des consommations d’énergie primaire utilisées pour produire les intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires). La production d'énergie correspond à la quantité d’énergie brute contenue dans les produits récoltés (quelle que soit leur destination finale)
Description de la technique
- 2 à 3 faux-semis suivant l’efficacité et le taux de relevé d’adventices
- Dès l’apparition d’adventices : deux passages au vibroculteur (le premier à 10-12 cm, le second à 5-6 cm) suivi d’un passage de rouleau après quelques jours
Le vibroculteur permet d’ameublir le sol et de créer les conditions favorables à la germination des graines d’adventices. Le rouleau permet de rappuyer le sol et de créer un contact étroit entre le sol et les graines d’adventices.
- Eventuellement un 3ème passage à la herse étrille (2-3 cm) avant le semis et sans attendre de dépasser le stade filament des adventices (2-3 cm)
Quel bilan ?
Cette stratégie limite fortement le salissement (adventices annuelles) des parcelles qui sont semées en culture d'été. Cependant, cette succession d'interventions est coûteuse en temps et en charges de mécanisation. Ce coût est "amorti" par la culture de maïs qui atteint des niveaux de rendements élevés. En sarrasin, les rendements sont plus aléatoires et cette culture couvrante est très compétitive : on pourrait donc remettre en question cette stratégie en amont du sarrasin. Mais nous avons aussi observé lors d'un démarrage hétérogène de la culture (manque d'eau par exemple), une très forte compétition d'adventices comme le chénopode blanc ou la renouée persicaire. Réduire le nombre de faux-semis représente donc un risque aussi avec le sarrasin. Autre précaution : cette séquence d'interventions affine le sol, attention donc sur les parcelles à fort risque érosif.
Description de la technique
Notre système étant adossé à un atelier de poules pondeuse (production sous contrat et très peu de fabrication d'aliment à la ferme en Bretagne), il est possible de produire des cultures à destination de l'alimentation humaine. C'est le cas ici avec l'avoine de floconnerie et le sarrasin.
Quel Bilan ?
Pendant les 4 ans d'essais (2019-2022), l'avoine a été valorisé en floconnerie une seule année, par manque de PS (seuil à 50). Le déclassement en avoine fourragère a une conséquence économique forte et il n'y a pas de levier agronomique permettant de sécuriser ce critère. Le sarrasin a un rendement aléatoire (de 0 à 24 q/ha), lié à des conditions qui ne sont pas encore maîtrisées (en lien avec les coulures de fleurs pendant une floraison indeterminée). Les résultats économique de cette culture sont donc aléatoire.
Tous les leviers utilisés sur ce dispositif sont mobilisables sur une exploitation biologique.
La répartition des interventions a été testé à l'échelle d'une exploitation de 100 ha : le travail est réparti régulièrement au printemps malgré le labour de toutes les cultures (semis répartis du printemps à l'été). L'automne présente moins de jours agronomiquement disponibles pour le labour de 2 des 5 parcelles et leur semis dans la foulée. Le recours à l'ETA ou l'accès à un matériel à débit plus élevé est alors nécessaire certaines années.
La diversification de la rotation dépend des contrats de reprise des cultures par les collecteurs. Si ces contrats n'existent pas, identifier de nouveaux débouchés peut s'avérer nécessaire en système de culture sans prairie.
Bien que le temps de travail soit équivalent au SdC moyen breton, il est légitime de se questionner sur la possibilité de réduire la perturbation du sol. En effet, toutes les cultures sont labourées annuellement afin de limiter le salissement de début de cycle et garantir des conditions de sol propices au désherbage mécanique, notamment avec la herse étrille. Actuellement, la règle de décision pour l'utilisation de la charrue repose sur l'enherbement de la saison précédente et de la présence d'adventices vivaces : la pression adventice importante ne nous permet pas, en l'état des RDD, de nous passer de cette pratique.
Autre séquence qui nous interroge : les faux-semis en amont du maïs et sarrasin. L'objectif est double : i) limiter les levées de flore annuelle dans le maïs et garantir un faible salissement en combinant ces faux-semis à du hersage et du binage ii) limiter la pression adventice à l'échelle de la rotation en déstockant des adventices (en amont du sarrasin). Or le stock en graines adventices est a priori très élevé. Le second objectif est donc discutable.