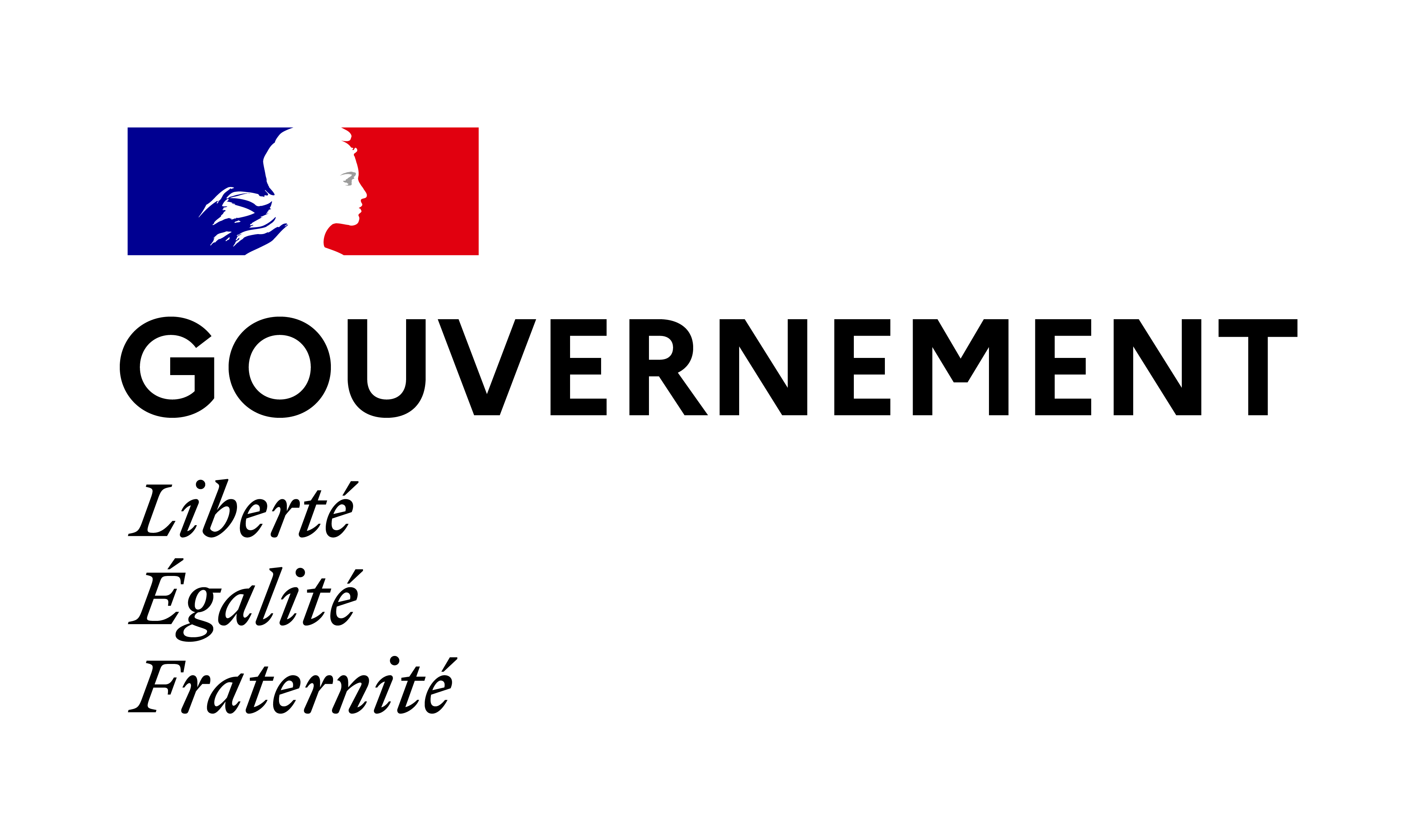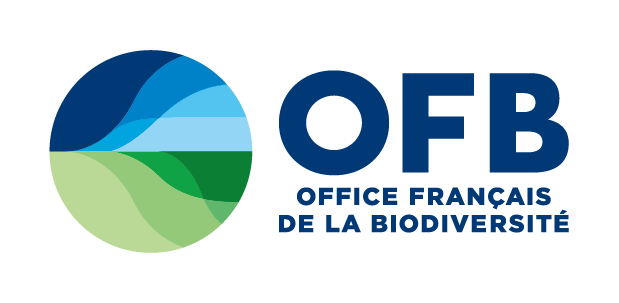Site Courcelles-Chaussy - MACC 0

L'observatoire piloté de Courcelles-Chaussy est situé sur l’exploitation du Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy. Il s'agit d'une exploitation de polyculture - élevage laitier, d'une SAU de 184 ha. La parcelle retenue est la parcelle « Golias » de 6.43 hectares, conduite en semis direct. Elle est bordée à l’est et à l’ouest de bois, et au nord et au sud de talus enherbés où les campagnols des champs sont installés.

La proportion de surfaces toujours en herbe (prairies) est relativement importante dans l'environnement. Ce type d'habitat est favorable à l'activité des campagnols des champs. Historiquement, le site est soumis à de fortes pressions des campagnols des champs, notamment sur les jeunes colzas.
Le choix de ce site permet en outre d'établir un lien vers l'enseignement agricole, via des restitutions et la participations d'étudiants aux actions mises en place.
| Climat | Sol |
| Semi-continental | Limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides |

L'espèce est sujette à des fluctuations d'abondance pluriannuelles et saisonnières qui se caractérisent par des augmentations et diminutions de populations. A nos latitudes, les populations sont plus importantes à l’automne qu’à la sortie de l’hiver. Lors des périodes d’augmentation, les densités observées peuvent être très spectaculaires, avec plusieurs milliers d’individus par hectare.
Le campagnol des champs est avant tout un herbivore, mais il consomme aussi des graines et des racines. Il mange environ 2 fois son poids en matière verte par jour.
S’il n’est pas maîtrisé, ses dégâts peuvent être conséquents en particulier sur céréales sur lesquelles les pertes après épiaison peuvent atteindre 40 à 60%, et sur les jeunes colzas.
En Moselle, les cultures de céréales et de colza restent prépondérantes, et s'ils sont difficiles à quantifier, les enjeux socio-économiques liés aux campagnols des champs sont importants.
La forte proportion de prairies dans l'environnement du site est un facteur de risque. En effet, les populations de campagnols des champs investissent prioritairement les surfaces toujours en herbe (prairies, bordures de parcelles, bandes enherbées, fossés…) qui leur servent de refuge contre les rapaces ou les activités humaines.
Au sein du projet MACC 0, le site de Courcelles-Chaussy est un observatoire piloté.
Deux objectifs sont poursuivis :
- Evaluer l’efficacité d’une bande répulsive en bordure de parcelle sur les populations de campagnols des champs, comme alternative à l’utilisation de rodenticides.
- Mettre en place un suivi des populations de campagnol des champs sur le long terme afin de mieux appréhender les dynamiques spatiales et temporelles dans le paysage.

La parcelle est divisée en deux blocs homogènes :
- Bloc A : Bloc témoin
- Bloc B : Implantation d’une bande répulsive en bordure du talus enherbé
La bande répulsive est installée sur une longueur de 180 mètres pour 2.50 mètres de large.
Elle est composée de trois bandes distinctes :
- une bande de fritillaire impériale (Fritillaria imperialis), une vivace de la famille des Liliacées, dont l'odeur particulière éloignerait les campagnols des champs. Les bulbes ont été implantés à l'automne 2019, à raison de 2 bulbes par mètre.
- une bande de mélilot (Melilotus officinalis), une légumineuse appétente pour les micromammifères, contenant du mélilotoside (précurseur de la coumarine), qui se transforme par action bactérienne (fermentation) en dicoumarol, molécule anticoagulante longtemps utilisée comme rodenticide. Le mélilot sera semé au début de chaque printemps.
- une bande mélangeant de la moutarde blanche (Sinapis alba), du sarrasin (Fagopyrum esculen) ainsi que de la gesse commune (Lathyrus sativus), ayant un effet répuslif voire neurotoxique pour la gesse sur les campagnols des champs. Le mélange sera semé au début de chaque printemps.

La bande de mélilot sera broyée à la fin du printemps de chaque année afin d'évaluer son impact sur les populations de campagnols des champs au sein de la parcelle.
Le projet MACC0 fait l’objet d’un suivi complet, à différentes échelles paysagères.
Suivi des densités de populations à l'échelle de la parcelle
Le broyage annuel de la bande de mélilot déclenchera le suivi au sein de la parcelle. L'évaluation des populations de campagnols des champs se fait par observation de la présence des micromammifères par intervalles de 10 mètres, à J-1 avant le broyage, à J+21 et à J+42. L'observation se fait sur la bordures des blocs (témoin et expérimental) et au sein de chaque bloc, qui seront divisé en 3 sous-blocs d'environ 1 hectare afin d'évaluer la variabilité intra-parcellaire.
Elaboration des transects pour le suivi Campagnols
Ce parcours d’une dizaine de kilomètre sera réalisé à l’identique chaque année sur le site, dans l'environnement autour de la parcelle. Il permettra d’avoir un suivi sur le long terme (année n à n+6) des densités de campagnols 2 fois/an (printemps et automne), sur la base d’une méthode indiciaire légère pour mieux appréhender l’évolution spatio-temporelle des populations dans différents habitats.

En bleu : parcelle observatoire piloté
Elaboration des parcours IKA nocturnes pour le suivi des prédateurs
L’objectif est d’estimer les tendances évolutives de faune sauvage prédatrice de micromammifères en utilisant la méthode de comptages nocturnes aux phares pour calculer un indice kilométrique. Il s’agit également d’un suivi sur le long terme (année n à n+6).
Sélection des postes d’observation diurne pour le suivi des prédateurs
Le suivi des prédateurs sera également réalisé par des observations à poste fixe, ainsi que des relevés de pièges photographiques et des analyses génétiques de poils (ce dernier point est dédié aux petits mustélidés, dont l’observation est très difficile, mais qui sont, pour certains, des consommateurs quasi-exclusifs de campagnols des champs).

Poteaux perchoirs équipés de pièges photographiques
Réalisation d’un diagnostic paysager
Un diagnostic paysager initial sera réalisé afin de caractériser l’environnement dans lequel évoluent les campagnols et leurs prédateurs. Cette approche à une échelle territoriale est nécessaire de manière à pouvoir mieux tenir compte du déplacement des prédateurs. En effet, il est difficile, voire impossible, de quantifier l’impact des prédateurs à l’échelle parcellaire, mais leur présence fait partie intégrante des méthodes alternatives de lutte contre les campagnols.
La problématique des campagnols est étroitement liée aux paysages, et notamment la raréfaction des haies, bosquets, … qui sont à la fois des refuges aux prédateurs et des barrières physiques pour les campagnols. A l’échelle du projet, des changements paysagers comme ceux-là nécessitent une période de temps trop importante pour en mettre en place et en quantifier l’impact sur les populations de prédateurs et de campagnols.
Au cours du projet, l’installation de perchoirs à rapace permettront de favoriser la prédation.
La parole de l'expérimentateur :
Contenu à venir