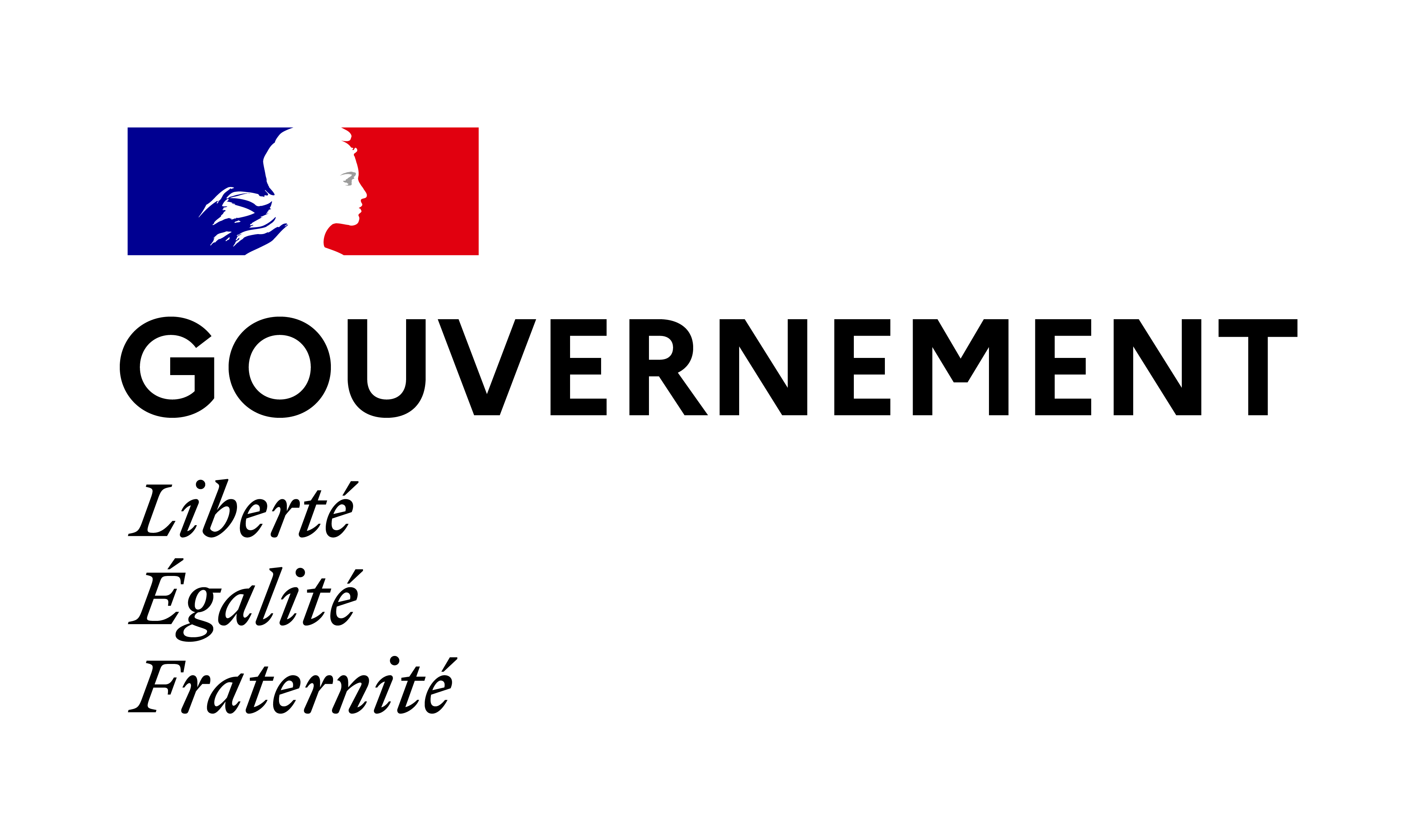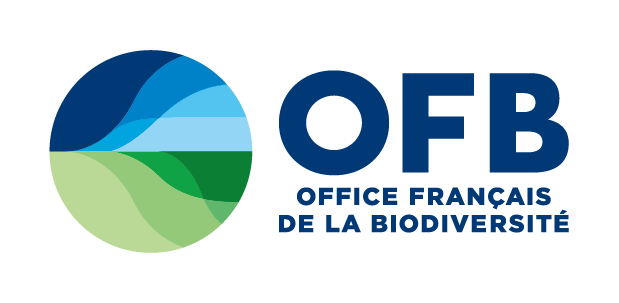Système GRAB - COSYNUS
Conception du système
La conception du système a été élaborée par étapes :
- La définition des objectifs : priorisation des objectifs intermédiaires et finaux, définition d’indicateurs communs permettant d’évaluer la pertinence des stratégies mises en œuvre (critères de choix pour les règles de décision). Ces indicateurs sont d’ordres agronomiques, technico-économiques, environnementaux et peuvent être quantitatifs ou qualitatifs.
- L’état des lieux des aménagements disponibles (recensement des leviers) : l’expérience des partenaires, la bibliographie, les remontées d’informations provenant des producteurs des réseaux DEPHY FERME ont permis de recenser l’ensemble des aménagements envisageables, et plus globalement des stratégies de protection mobilisables.
- La co-construction techniciens/producteurs/chercheurs des stratégies à mettre en œuvre sur les sites d’essai : cette phase décisionnelle a été décisive en début de projet. Les partenaires ont collectivement hiérarchisé les différentes stratégies (coût, faisabilité, efficacité attendue) pour sélectionner les plus prometteuses. Un socle commun de mesures mises en place sur l'ensemble des sites a ainsi été défini. Chaque mesure a fait l’objet d’une fiche technique interne commune (exemple d’une bande fleurie : espèces, densité de semis, date de semis, action envisagée sur les ravageurs) explicitant les règles de décision régissant leur mise en œuvre, ainsi que les objectifs à atteindre. Cette co-construction est renouvelée, en fonction des échecs ou succès, chaque année, en lien avec les autres sites et avec le réseau DEPHY FERME. En fonction des contraintes propres à chaque site, les règles de décision et les objectifs (intermédiaires et finaux) peuvent être ajustés lors d’ateliers de co-construction ; le producteur accueillant l’observatoire piloté a une voix prépondérante sur la sélection des dispositifs mis en place.
Mots clés :
Aménagement - Préventif - Auxiliaires indigènes - Faisabilité - Coût - Efficacité
Caractéristiques du système
Une des rotations type en maraîchage sous abris non chauffé est la séquence solanacée / salade / cucurbitacée / salade. Malgré les variabilités dues aux variations inter-annuelles des bioagresseurs et aux zones climatiques différentes, l’aubergine et le concombre sont les cultures d’été subissant le plus de traitements. Le système de culture testé reprend cette rotation, et les cultures de concombre et aubergine y sont privilégiées. Cette rotation est mise en place trois fois pendant la durée du projet, avec éventuellement des différences de choix d’espèces, à l’intérieur de la même famille botanique.

|
Situation de production : Production maraîchère en AB, sous tunnel plastique non chauffé (région d'Avignon) Espèces : Aubergine, concombre, légumes feuille d'hiver Gestion de l'irrigation : Goutte à goutte ou aspersion Fertilisation : Organique Interculture : Pas d'interculture Gestion du sol/des adventices : Travail mécanique et paillage Circuit commercial : Long, essentiellement expédition Infrastructures agro-écologiques : Nombreux aménagements (gestion de l'enherbement, bandes fleuries, plantes mellifères, haies, plantes-relais, plantes-ressources), transfert actif vers les cultures Gestion du climat pour les systèmes sous abri : Bassinages, ouverture/fermeture des ouvrants |
|
Agronomiques |
|
| Environnementaux |
|
|
Maîtrise des bioagresseurs |
|
|
Socio-économiques |
|
Le système de référence est un système de culture à dire d'experts actualisé chaque année. Différents techniciens proches géographiquement du site expérimental, ainsi que les ingénieurs réseau des Dephy Ferme impliqués dans le projet sont interrogés chaque année. Ils font ainsi remonter les itinéraires, les problèmes phytosanitaires (coûts de protection, pertes de récolte) de parcelles dénuées d'aménagements agroécologiques, ce qui permet d'élaborer un système de référence fiable et actualisé.
Aujourd’hui, les systèmes de production doivent évoluer afin de satisfaire l’attente sociétale et environnementale visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. En production maraîchère sous abris froids, les bioagresseurs (principalement les ravageurs) pénalisent les performances des exploitations, à causes des pertes de récolte engendrées (quantité et qualité) et d’une gestion aux coûts importants (en intrants et en main d’œuvre).
Favoriser la biodiversité fonctionnelle par l’installation d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) apparait comme une solution durable pour réguler les ravageurs sous abris. Les objectifs du projet sont de :
- Démontrer la faisabilité et l’intérêt de cette approche et proposer des IAE et des stratégies d’optimisation des services rendus, réalistes et concrets.
- Obtenir des références technico-économiques et environnementales sur un Système de Culture (SDC) typique des exploitations maraîchères sous abris.
- L’enjeu sur ce site est de renforcer grâce aux aménagements agroécologiques la performance de l’exploitation en réduisant les coûts en intrants, et de réduire la pénibilité du travail. En démontrant la faisabilité technique et la pertinence économique d’une conduite biologique, les résultats de ce projet peuvent contribuer à augmenter la part de l’AB dans le maraîchage au niveau français et ainsi permettre de réduire la consommation de produits phytosanitaires au niveau national.
Le mot de l'expérimentateur
La mise en oeuvre d'aménagements agroécologiques à l'échelle de l'exploitation a permis des résultats probants dans ce système GRAB-COSYNUS situé sur une exploitation commerciale, tant en termes de résultats agronomiques qu'économiques. L'efficacité de cette combinaison de leviers agroécologiques (qui n'excluent pas les leviers classiques de gestion comme la lutte biologique, la prophylaxie, l'application de produits, etc.) est optimale si le suivi et l'entretien des aménagements sont véritablement considérés comme partie prenante de l'itinéraire technique de la culture.
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Diagnostic agro-environnemental | Identifier sur l'exploitation des infrastructures agroécologiques intéressantes pour la biodiversité, afin de les préserver. Identifier des zones plus pauvres permettant de créer des aménagements favorables et/ou des corridors écologiques. Faire des propositions d'aménagements au producteur. | Il n'existe pas de méthodologie établie de diagnostic à l'échelle de la ferme, concernant les infrastructures agro-écologiques favorables aux auxiliaires. Les connaissances des associations naturalistes sont intéressantes. Ces diagnostics sont primordiaux mais restent compliqués à réaliser pour un producteur sans accompagnement |
| Aménagements extérieurs | La plantation de haie composite et/ou le semis de bandes fleuries permettent de diversifier les habitats et les sources de nourriture pour les auxiliaires, à l'échelle de l'exploitation. Les haies profitent aussi aux oiseaux, chauve-souris, mustélidés, hérissons, etc. | Les haies s'envisagent sur le long terme, en tenant compte de multiples facteurs (arrosage, ombre portée, circulation des engins, fonction brise-vent). Les bandes fleuries doivent être renouvelées tous les 3-4 ans (en même temps que les changements de bâche) car la flore spontanée recolonise rapidement ces espaces. |
| Aménagements intérieurs | Les aménagements intérieurs (pérennes ou annuels) fournissent des habitats et/ou de la nourriture (pollen, nectar, proies/hôtes de substitution) au plus proche de la culture. L'objectif est que les auxiliaires trouvent des ressources toute l'année dans l'abri, même quand la culture n'est pas favorable. | Certaines stratégies comme les plantes-relais se sont avérées décevantes. Les semis de céréales à l'automne ont permis une fourniture précoce d'auxiliaires contre pucerons courant avril. L'achillée, l'alysse abritent une belle diversité d'auxiliaires toute l'année. Le souci héberge de nombreux Macrolophus ; le transfert actif vers la culture permet d'accélérer et homogénéiser la colonisation de la culture. Il faut replanter régulièrement les aménagements pour remplacer les plants morts. |
| Lutte biologique | Faire ponctuellement un apport massif d'auxiliaires quand les auxiliaires indigènes sont trop peu nombreux. Inoculer des aménagements sur lesquels les populations d'auxiliaires indigènes seraient trop faibles. | Grâce aux aménagements et aux auxiliaires indigènes, il a été possible de réduire fortement les lâchers d'auxiliaires. Les principaux auxiliaires lâchés sont les chrysopes, les coccinelles, les acariens prédateurs. |
| Prophylaxie | En s'appuyant sur une surveillance régulière des cultures, procéder à une élimination précoce des organes/plantes fortement attaquées. Gérer le climat pour créer des conditions défavorables aux ravageurs. | Les bassinages s'avèrent efficaces pour une bonne gestion des acariens tétranyques, d'autant que les acariens prédateurs ont besoin d'une atmosphère relativement humide. La pratique du bassinage (dose, fréquence, horaires) reste encore empirique. |
| Produits de biocontrôle | Utilisés de façon préventive contre les mollusques ; Application en ultime recours quand les autres leviers se sont avérés insuffisants. | La gestion des acariens tétranyques est la plus problématique, sur aubergine comme sur concombre, et a nécessité des traitements. Certains produits de biocontrôle présentent des efficacités faibles. |
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Prophylaxie | Créer des conditions défavorables aux ravageurs et maladies. Limiter l'inoculum au tout début de l'attaque | La pratique des bassinages nécessite un juste dosage afin de ne pas créer de conditions trop favorables aux maladies (ex : mildiou sur concombre) |
| Produits de biocontrôle | En dernier recours, quand les autres leviers sont insuffisants. Application précoce dès les premiers symptômes | Une détection précoce des premiers symptômes est nécessaire pour déclencher les traitements fongicides (uniquement produits de contact). |
Cultures d'hiver :
| année | culture | mildiou | pucerons | mollusques | chenilles | ||||
| Cosynus | Ref | Cosynus | Ref | Cosynus | Ref | Cosynus | Ref | ||
| 2019 | épinard | ||||||||
| 2020 | salade | ||||||||
| 2021 | salade | ||||||||
| 2022 | salade | ||||||||
| 2023 | épinard | ||||||||
5 cultures d'hiver ont été suivies dans cet essai système.
Elles ont été épargnées par les pucerons, sans lâcher de chrysopes ni traitement. Aucun traitement n'a été nécessaire contre le mildiou. Pour les mollusques et les chenilles, quelques traitements avec des produits de biocontrôle ont été réalisés. Au final, les dégâts dus à ces deux ravageurs sont minimes.
Cultures d'été :
| année | culture | oïdium | mildiou | pucerons | acariens | thrips | aleurodes | ||||||
| Cosyn | Ref | Cosyn | Ref | Cosyn | Ref | Cosyn | Ref | Cosyn | Ref | Cosyn | Ref | ||
| 2019 | aubergine | ||||||||||||
| 2020 | concombre | ||||||||||||
| 2021 | aubergine | ||||||||||||
| 2022 | concombre | ||||||||||||
| 2023 | aubergine | ||||||||||||
| 2024 | courgette | ||||||||||||
6 cultures d'été ont été suivies dans cet essai système.
Les thrips et les aleurodes, présents mais en effectifs faibles, n'ont pas nécessité de gestion spécifique. Les auxiliaires généralistes présents dans la culture ont permis une bonne régulation.
Comme attendu, ce sont les pucerons et les acariens tétranyques qui ont été les plus problématiques. Certaines années, les pucerons, présents parfois sur les plants récupérés de pépinière, ont pu être contrôlés précocément en avril-mai notamment grâce aux céréales et leurs pucerons spécifiques. D'autres années, des lâchers de prédateurs aphidiphages ont du être réalisés pour contrôler leur population. Au final, les attaques ont été contrôlées.
Les acariens sont les ravageurs pour lesquels les leviers classiques de gestion sont peu satisfaisants. Les dégâts les plus importants ont été observés en 2020 et 2021 dans le système COSYNUS. Sur concombre, l'arrêt des bassinages à cause du mildiou a provoqué des conditions climatiques chaudes et sèches favorables aux acariens tétranyques et défavorables aux acariens phytoséiides. A partir de 2022, malgré une présence de plus en plus précoce en saison, les acariens tétranyques ont été efficacement contrôlés grâce aux bassinages, aux acariens phytoséiides, et aux transferts localisés de Macrolophus.
Performance agronomique
Rendement (en kg/m² ou en fruits/m²)
Les performances agronomiques sont proches dans les deux systèmes de culture.
Les différences de rendement entre les deux systèmes de cultures sont essentiellement expliquées par l'intensité de l'attaque d'acariens. En 2021 sur aubergine, c'est le système COSYNUS qui a subi les pertes de rendement les plus importantes, alors même que la pression acariens dans le système de référence s'est avérée forte et a entraîné des dégâts importants. En 2019 sur aubergine et en 2022 sur concombre, c'est le système de référence qui a subi les pertes de rendement les plus importantes, à cause d'une moins bonne régulation des acariens.
En 2022, les rendements moyens s'expliquent principalement par des problèmes de conduite (manque de main d'oeuvre entraînant des retards de taille/palissage). En 2024, le rendement de la courgette a été faible à cause d'une gestion trop tardive de l'oïdium.
Performance environnementale
IFT gestion des ravageurs
Le site expérimental étant situé sur une exploitation en AB, aucun produit phytosanitaire hors biocontrôle n'a été utilisé. Les principales applications concernent les limaces et escargots pour lesquels de l'orthophosphate de fer est épandu en préventif sur la périphérie des parcelles. Les principales cibles des traitements sont les acariens.
Les traitements contre pucerons, acariens, aleurodes ont été réalisés en dernier recours, sur des populations bien installées de ravageurs. Dans ces conditions, les efficacités observées sont clairement insuffisantes.
Performance économique
Charges de gestion des bioagresseurs (€/m²)
L'analyse des coûts liés à la protection des cultures (intrants et main d'oeuvre pour limiter maladies et ravageurs) montre que le système COSYNUS permet globalement de limiter les charges. Sur les 6 ans de suivi (en prenant aussi en compte les cultures d'hiver), la mise en oeuvre des aménagements mobilise de la main d'oeuvre supplémentaire (plantation, surveillance, transfert actif) de l'ordre de 26%. Elle permet cependant une économie forte au niveau des intrants, de l'ordre de 50%, essentiellement grâce à la réduction des achats d'auxiliaires lâchés. Au total, les charges de gestion des bioagresseurs sont réduites de 27%.
En considérant la marge dégagée sur les 6 ans du suivi (6 cultures d'été + 5 cultures d'hiver), la marge nette est supérieure de 15% dans le système COSYNUS, en comparaison au système de référence.
Lecture du graphique : Tous les points qui se trouvent en-dessous de la ligne "1" sont en dessous de l’objectif. Tous les points qui se trouvent au dessus de "1" dépassent l’objectif
Sur ce site expérimental, l'enjeu est plus d'améliorer la performance de l'exploitation que de diminuer l'IFT (ferme en AB).
Les objectifs sont globalement remplis : s'appuyer sur des leviers préventifs de gestion des ravageurs (aménagements agroécologiques) n'a pas entraîné de pertes de rendement. Dans le système COSYNUS, la marge nette a été améliorée d'environ 15% grâce à la réduction des achats d'intrants (principalement lâchers d'auxiliaires achetés) . En considérant les 6 ans de suivi et la globalité des charges de culture, les charges de main d'oeuvre sont augmentées de 1,5% et les intrants diminués de 6,5% dans le système COSYNUS.
Une bande de céréale semée en bordure de tunnel à l'intérieur de l'abri peut constituer un très bon réservoir d'auxiliaires contre les pucerons. Les céréales peuvent en effet héberger des pucerons spécifiques des graminées. Ceux-ci vont servir de garde-manger aux auxiliaires pouvant ensuite s'attaquer aux pucerons des cultures.
Les céréales (blé, orge, seigle, ou simple grain à poules) sont semées juste avant la plantation de la culture d'automne courant septembre. Un petit sillon est ouvert à la binette ; la dose de semis est d'environ 1kg pour 100 mètres linéaires, sur environ un quart de la longueur de l'abri. Les aspersions pendant l'automne-hiver permettent la levée des céréales.
Dans le système COSYNUS, cette pratique a permis une présence importante d'auxiliaires (parasitoïdes et coccinelles) avant même la plantation de la culture de printemps-été. La régulation des premiers foyers de pucerons sur la culture a ainsi été très bonne. Malheureusement, cet aménagement n'est fonctionnel que si les céréales sont colonisées par les pucerons spécifiques des graminées, ce qui a été le cas 3 années sur 5.
Ce résultat confirme l'intérêt à diversifier les aménagements sur les exploitations. Les bandes fleuries d'alysse et d'achillée hébergent par exemple des auxiliaires contre pucerons, en effectifs moindres que dans les céréales, mais beaucoup plus régulièrement.
L'essai a été réalisé sur une exploitation agricole, dans des conditions de production représentatives de la région. Les leviers testés sont donc réalistes et facilement transférables. Les visites organisées sur le site, les formations réalisées, le témoignage du producteur accueillant l'essai, les informations relayées par les animateurs des Dephy Ferme ont permis la diffusion des résultats de cet essai, ce qui a d'ores et déjà permis la mise en oeuvre de certaines des stratégies testées sur d'autres exploitations, y compris hors de la zone méditerranéenne.
Cet essai a permis de montrer l'intérêt des aménagements agroécologiques pour la régulation des ravageurs.
Les résultats sont intéressants pour la gestion des pucerons, acariens, aleurodes, Tuta sur la première moitié du cycle cultural. Les attaques plus tardives sont dans l'ensemble moins bien régulées grâce aux auxiliaires indigènes. Des travaux sur des nouvelles espèces de plantes de service ou des calendriers d'implantation différés seraient nécessaires pour prolonger la fourniture d'auxiliaires indigènes.
D'autres ravageurs comme Drosophila suzukii, les punaises, les altises, les doryphores restent problématiques. Pour ceux-ci, la gestion basée sur la biodiversité fonctionnelle reste très hypothétique.
Des règles de décision concernant la gestion des pucerons ont été élaborées. Elles permettent de mobiliser les différents leviers (prophylaxie, auxiliaires indigènes, lutte biologique, traitements) en fonction de seuils d'intervention (niveau d'attaque, présence d'auxiliaires, âge de la culture,...). Ces travaux préliminaires nécessitent d'être complétés/validés avant une utilisation à plus large échelle.