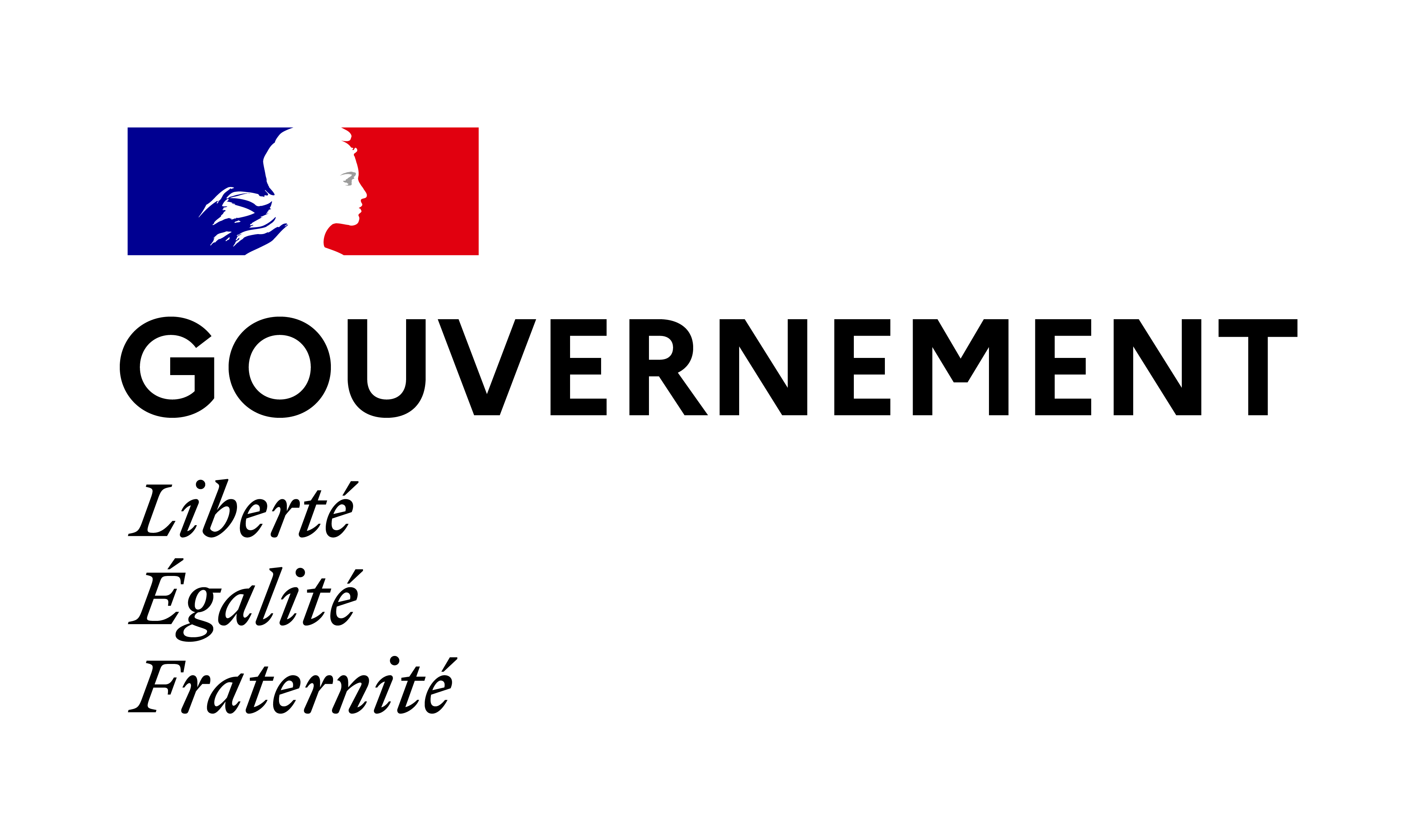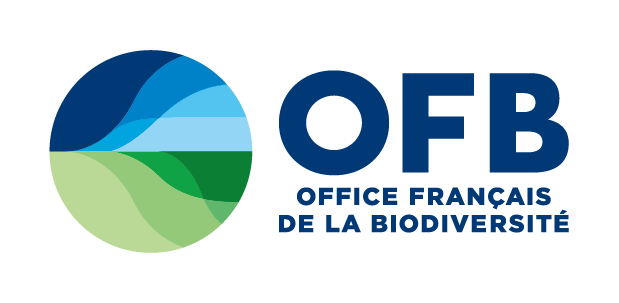Système SI - ESC SYPPRE - REDUCE

Conception du système
Le système innovant a été conçu pour répondre à des enjeux de multi-performance (performance économique, réduction de la dépendance aux intrants, fertilité des sols et protection conte l’érosion, …) dans le contexte des coteaux argilo-calcaires en s’appuyant sur une combinaison de leviers (allongement et diversification de la rotation, couverture des sols, introduction de légumineuses, …).
Mots clés :
Combinaison de leviers - Allongement de la rotation - Couverture du sol - Réduction des intrants - Economie des exploitations
Caractéristiques du système

CI = Couvert Intermédiaire
Le système innovant a été co-conçu avec des partenaires et agriculteurs locaux afin de répondre aux objectifs suivants :
- Améliorer la performance économique et la robustesse : la stratégie s’est portée sur un compromis entre une rotation longue et diversifiée en vue de lutter contre les bioagresseurs (et notamment les adventices problématiques sur la plateforme) et un choix stratégique de maintien dans la rotation, d’une quantité non négligeable de cultures rémunératrices afin de préserver la performance économique.
- Améliorer la fertilité des sols et limiter les risques d’érosion : la stratégie s’est portée sur une couverture quasi – complète des sols (+90 %), avec la mise en place de deux couvertures successives entre une culture d’hiver et une culture d’été, des cultures dérobées d’opportunité pouvant servir de couvert, et des couverts associés sur la culture de colza.
- Réduire la dépendance aux intrants : la stratégie s’est portée sur la réduction des apports de fertilisants et sur la réduction des produits phytosanitaires avec une double entrée : la diminution globale des apports avec des stratégies multiples depuis la rotation jusqu’à la combinaison de leviers agronomiques, l’arrêt progressif ou utilisation en dernier recours du glyphosate et l’arrêt du s-métolachlore.
- Améliorer le bilan énergétique et réduire les émissions de GES : la stratégie s’est portée sur l’amélioration du bilan carbone au travers l’apport de biomasse pour stocker du carbone, mais également la réduction des émissions de GES au travers des diminutions sur la fertilisation des cultures.
|
Agronomiques |
|
| Environnementaux |
|
|
Maîtrise des bioagresseurs |
|
|
Socio-économiques |
|
Le mot de l'expérimentateur
Le système innovant a été conçu pour répondre à des enjeux de multi-performance (performance économique, réduction de la dépendance aux intrants, fertilité des sols et protection contre l’érosion, …) dans le contexte des coteaux argilo-calcaires en s’appuyant sur une combinaison de leviers (allongement et diversification de la rotation, couverture des sols, introduction de légumineuses…)
Les interventions culturales sont réalisées selon un schéma décisionnel qui définit a priori les stratégies, les règles de décision et les « routines » (pratiques appliquées systématiquement). La formalisation a priori du schéma décisionnel est cruciale et permet, en fin de campagne d’évaluer les règles de décisions et de les faire évoluer si besoin. Les stratégies mises en œuvre sur la plateforme sont multiples et concernent à la fois des choix et des positionnement des espèces au sein de la rotation jusqu’à l’adaptation de l’itinéraire technique en culture.
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

Les mesures réalisées sont définies au protocole et décrites par des modes opératoires; elles ont différents objectifs : (1) piloter les cultures, (2) évaluer le niveau de satisfaction des stratégies et des règles de décision mises en œuvre, (3) réaliser un diagnostic agronomique (quantification des facteurs limitants du rendement), et (4) évaluer les performances des systèmes de culture par rapport aux objectifs de conception.
L’ensemble de ces mesures ont permis de réaliser l’analyse multicritère des deux systèmes (schéma ci-après).
Les grandes conclusions au regard des objectifs fixés de la plateforme sont :
a. Réduire la dépendance aux intrants
A l’échelle du système, il y a une différence significative en faveur du système innovant pour la dépendance aux intrants azotés, de l’ordre de 40 KgN/ha en moyenne. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées : la première, est la logique diminution des apports de fertilisants en raison de la présence plus importante de légumineuses dans la rotation, qui de facto, diminue la quantité totale d’azote apportée à l’échelle du système. Néanmoins, sur un certain nombre d’espèces, une stratégie de pilotage et de réduction des apports azotés a été mise en œuvre. Elle a porté ses fruits notamment en ce qui concerne la culture du blé dur, avec des apports diminués de l’ordre de 70 kgN/ha.

Figure 7 : Quantité d’azote minéral apportée en moyenne pour chaque année et par système
A l’échelle du système innovant, l’IFT total (TS inclus) est resté globalement stable, avec une variation en fonction des années. L’IFT total (TS inclus) du système innovant est légèrement supérieur à celui du témoin, notamment par une augmentation de l’utilisation de produits de biocontrôles dans la lutte contre les ravageurs des cultures. Lorsque l’on étudie l’IFT total hors biocontrôle, les deux systèmes sont assez similaires avec quelques variations selon les années climatiques (cf. graphique ci-dessous).

Figure 9 : IFT total hors biocontrôle (TS inclus) pour chaque année et par système
Certaines cultures du système innovant permettent des IFT plus bas tandis que d’autres, ont tendance à faire augmenter l’IFT global à l’échelle du système.
Plus spécifiquement à l’échelle de l’IFT Herbicide, l’IFT herbicide en culture n’a pas augmenté en moyenne suite à l’arrêt du glyphosate. On constate les mêmes évolutions sur les deux systèmes innovants et témoins.
b. Améliorer la fertilité des sols
La mise en place d’un système diversifié avec plus de 90 % de couverture du sol, une restitution chaque année d’une quantité non négligeable de biomasse, s’est traduit globalement par :
- Une augmentation de la teneur en matière organique, de l’ordre de 0.4 point en 6 ans. Le système témoin a continué d’évoluer également mais dans une moindre mesure, de par la présence d’un historique relativement bas (1.4 % au point initial), et de la mise en œuvre d’une restitution des pailles au sol.

Figure 11 : Variation de la teneur en Matière organique (%) dans le témoin et l’innovant
entre le point initial et le point intermédiaire de la rotation
- Une amélioration du comportement du sol face à l’érosion, qui a pu être visualisé sur site, mais également détecté grâce à des tests réalisés au champ.
c. Améliorer la performance économique
Pour mener à bien l’analyse économique, plusieurs choix méthodologiques ont été réalisés : les systèmes innovant et témoin ont été extrapolés sur la base d’une ferme fictive de 170 ha où toutes les cultures ont le même poids dans l’assolement. Dans le système innovant, chaque culture représente donc 21.25 ha à l’échelle de cette ferme. Le calcul a été réalisé uniquement sur la base de semences certifiées, y compris pour les couverts végétaux. Les prix de récoltes sont calculés sur la base d’une vente en direct après la moisson, aucune stratégie de commercialisation n’a été pris en compte. Le coût des intrants sont des coûts réels obtenus localement pour les quantités de la plateforme, ce qui peut induire un léger surcoût.
Malgré une baisse d’utilisation des fertilisants et une amélioration globale de la teneur en matière organique dans les sols et du comportement érosif, les résultats économiques du système innovant sont inférieurs à ceux du système témoin. Les principales raisons sont notamment l’introduction de cultures à plus faible marge directe ou à plus forte variabilité au contexte climatique. Le blé dur reste la culture la plus rémunératrice sur l’assolement, sa dilution à l’échelle d’une exploitation fictive de 170 ha fait baisser globalement la marge directe du système innovant. Les écarts entre témoin et innovant sont de l’ordre de 300 euros/ha, avec des variabilités en fonction des années, de 100 à 500 euros/ha.

Figure 14 : Variation de la marge directe avec aides selon les cultures (2020 à 2022)
A partir de 2018, le glyphosate a été progressivement arrêté sur la plateforme pour le système innovant, jusqu’à un arrêt total à partir de 2020. La gestion a été réalisée parcelle par parcelle, en fonction de la pression adventice et du contexte pédoclimatique.
Les densités de Ray Grass avant récolte ont globalement augmentées sur le système innovant, témoignant de difficultés de gestion en culture ou en interculture, néanmoins cela n’a pas été le cas sur toutes les parcelles, et cette augmentation de population a pu être contenue.
 |
 |
Les stratégies mise en œuvre ont été les suivantes :
- Sécurisation avec de la prélevée pour les céréales à pailles plutôt qu’un rattrapage à vue, de par la résistance du Ray-Grass.
- Décalage des dates de semis pour les céréales à pailles. Sur la plateforme, nous avons constaté les limites du décalage de la date de semis. Ce décalage est parfois antagoniste avec la non-utilisation du glyphosate, en effet, les périodes permettant une gestion mécanique des repousses s’amenuisent avec un décalage de la date de semis (cf. figure 18). En sol argileux et en conditions humides, le décalage de la date de semis peut être parfois contre-productif dans la gestion contre le Ray Grass (repiquages). La réalisation de faux semis ne garantit pas forcément de ne pas avoir de Ray Grass par la suite.
- Préparation du sol de manière optimale, semis sur un sol propre pour éviter les repiquages éventuels : ces stratégies ont globalement conduit à une augmentation du nombre de passage du sol de l’ordre de 1 passage de travail du sol supplémentaire dans le système innovant sans glyphosate, conduisant à une augmentation de la consommation de carburant d’en moyenne 10 L/ha.
- Sécurisation des cultures au travers : une levée rapide, qualité du semis, une densité suffisante, des plantes vigoureuses, fertilisation localisée.
- Densification des couverts et semis avec des outils adaptés afin de sécuriser la levée et la biomasse des couverts. Les couverts ne semblent pas entrainer de montées à graine des Ray Grass avant destruction mais, lorsqu’ils sont bien développés, permettent une concurrence au Ray Grass, qui est alors moins tallé et plus facilement gérable par des outils mécaniques. Les Ray Grass sont plus difficiles à détruire que les couverts, d’autant plus sans glyphosate.
- Binages du sorgho, tournesol, du pois chiche, et du colza, qui ont eu de bonnes efficacités.
- Herse étrille sur pois chiche qui permet de compléter le contrôle sur le rang des populations de Ray Grass, avec parfois des difficultés de mise en œuvre (fenêtres climatiques)
- Introduction de la charrue déchaumeuse comme alternative afin de lutter contre le ray-grass par un enfouissement des graines tout en limitant les risques érosifs. L’efficacité de cette technique est variable d’un point de vue de la gestion du ray-grass et demande une bonne maitrise technique car la profondeur de retournement est inférieure à celle d’une charrue et l’outil est dépourvu de rasette. La charrue déchaumeuse passée à 16-18 cm de profondeur, permet un retournement des graines de Ray Grass à 6 cm. Un travail superficiel reste donc possible, dans la mesure où il ne descend pas à une profondeur de plus de 5 cm, et permet la préparation d’un lit de semence pour la culture de rente.
- Travail de l’interculture avec un déchaumeur scalpeur, dans le but de scalper et déraciner les adventices et couverts en été, début d’automne. Le passage de cet outil est adapté à cette période climatique, car il peut engendrer des lissages en sol argileux en cas de conditions humides. Au final, l'outil est peu adapté en parcelle de coteaux, avec des difficultés à garder un travail du sol homogène suivant les hétérogénités du sol.
Les successions où l’arrêt du glyphosate peuvent être le plus problématiques sont les suivantes :
- Interculture avant Pois chiche : du fait de la date de semis de cette espèce et des conditions climatiques pour le travail du sol.
- Interculture entre le Couvert d’hiver et le sorgho ou le tournesol : lorsque la reprise au printemps s’avère délicate (printemps humides), favorisant le repiquage de Ray Grass déjà tallés dans la culture suivante.
- Interculture entre la CIVE (céréale d’hiver) et le sorgho : l’objectif étant de maintenir la céréale d’hiver suffisamment longtemps pour avoir de la biomasse, elle doit être détruite plus tard qu’un couvert hivernal (avril-mai). De ce fait, le travail du sol à cette période pourrait entrainer un assèchement du sol et une possible pénalisation de l’implantation du sorgho. Sans glyphosate, cette succession a dû être modifiée, au profit d’une couverture de sol durant l’été et l’hiver précédant, avec possibilité de détruire 1 mois avant implantation du sorgho.
Le projet Syppre a été initié par les instituts techniques Arvalis, Terres Inovia et Institut technique de la Betterave. Trois actions sont déclinées dans 5 territoires en France : un observatoire des pratiques, des plateformes expérimentales, des réseaux d'agriculteurs. L'objectif étant de construire ensemble les systèmes de cultures de demain. Les objectifs du projet Syppre, en coteaux argilo-calcaires du Lauragais, définis avec les partenaires locaux à l’horizon 2025, sont de permettre à l’agriculteur d’améliorer la fertilité des sols et la protection contre l’érosion, de maintenir une production de qualité sur les deux filières dominantes et d’améliorer la robustesse économique du système, dans des situations non irriguées. Un comité régional réunissant les partenaires locaux (agriculteurs, conseillers, chercheurs) a permis la co-construction d'un système innovant répondant à ces objectifs. La plateforme expérimentale a été implantée en 2015, depuis, plus de 3000 personnes, principalement des agriculteurs et des conseillers agricoles, ont eu connaissance de ces résultats : 900 visites sur sites ont été organisées, et plus de 1800 personnes ont été touchées dans le cadre d'interventions sur tout le territoire du Sud France. Nous constatons que les pratiques commencent à évoluer sur ce territoire.
Un réseau de 12 agriculteurs et 7 partenaires techniques est également animé depuis 2018 sur l'Aude, la vallée de la Lèze et le secteur du Lauragais, sur la thématique de la gestion des couverts dans les intercultures longues sur les sols argileux et sans irrigation.
Les actions de transfert se poursuivent notamment avec l'animation d'un colloque au champ le 6 juin 2024.
L’effet rotation a un poids important sur l’enherbement, mais n’est parfois pas suffisant pour garantir une totale gestion des mauvaises herbes. L’alternance de phases de semis direct et travail du sol semblent nécessaire à la gestion du Ray Grass sans glyphosate, entrainant parfois des passages répétés liés aux difficultés de gestion de Ray Grass développés (tallés) et entrainant un risque de dégradation de la structure. La charrue déchaumeuse a un impact non négligeable sur la gestion des adventices en proposant une lutte alternative.
L’introduction d’une seconde culture d’été en suivant le sorgho, par exemple sorgho-tournesol, pourrait permettre de faire baisser la pression adventice. Ces évolutions de rotation doivent également être étudiés au regard de la performance économique du système.