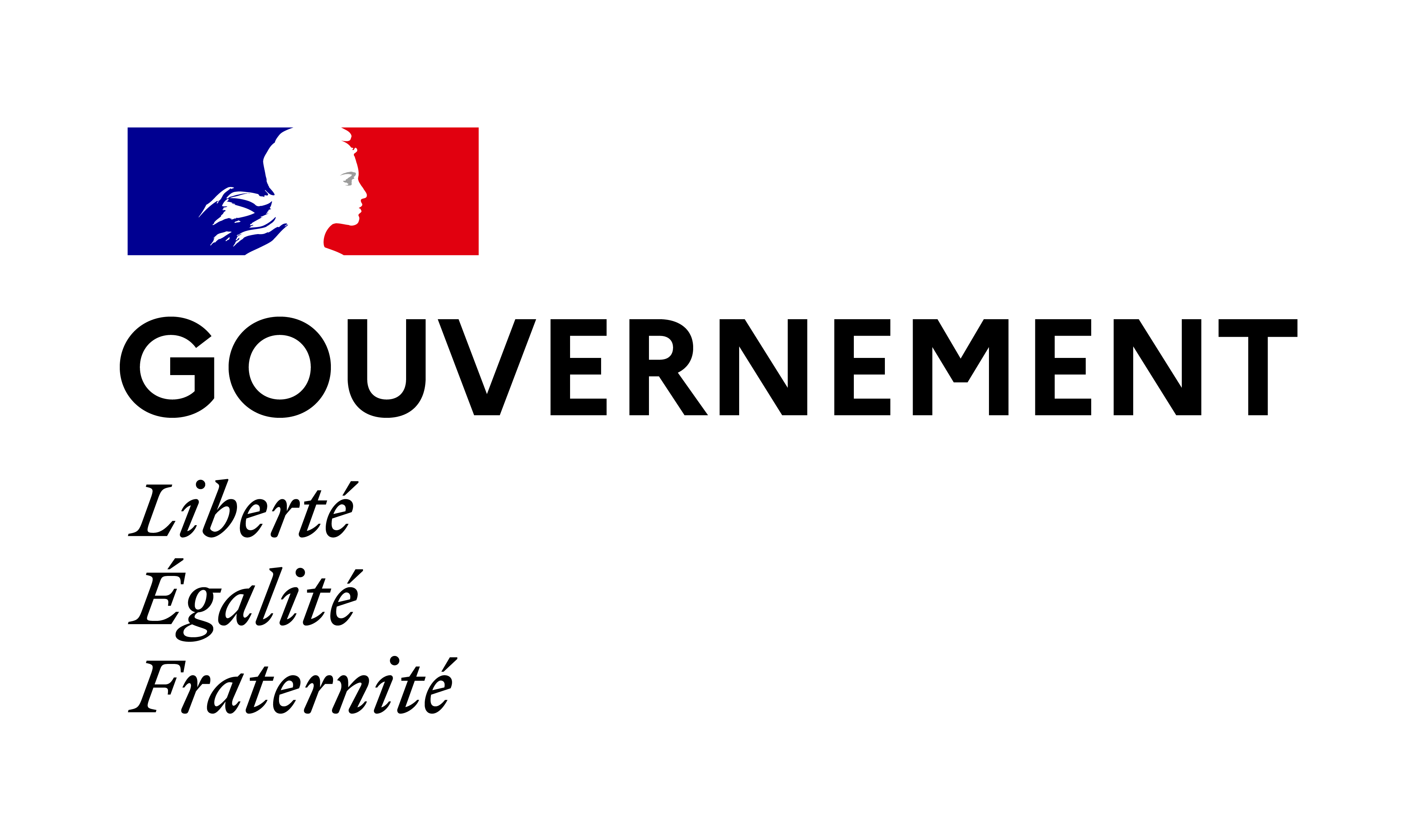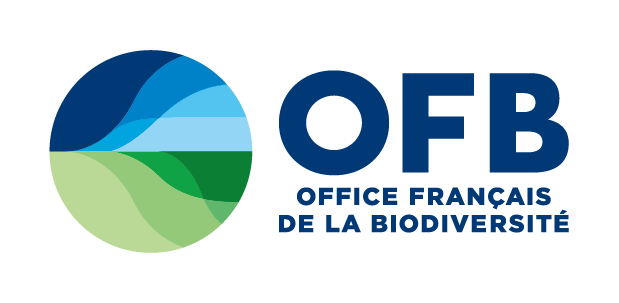Système TCS - ESC SYS_AUZ - REDUCE

Conception du système
En 2018, avec le démarrage des projets REDUCE et VACCARM, des ateliers de reconception se sont tenus impliquant des chercheurs (agronomes, modélisateurs), des techniciens, des conseillers et des agriculteurs. Leur but était d’ajuster les systèmes expérimentés aux projets et aux thématiques de l’UMR AGIR dans le contexte de l’arrêt de l’usage du glyphosate et de réduction du travail du sol.
S’appuyant sur l’expérience issue des projets de recherche qui ont précédé sur le domaine expérimental (légumineuses à bas niveau d’intrants (LGBI), l’ANR MicMac-design, Eco-puissance-4), le système « TCS » (Techniques Culturales Simplifiées) se place dans la transition vers l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) sans glyphosate et sans SMOC (S-métolachnlore).
Pour ce faire, le système « TCS » actionne des leviers tels que l’allongement de la rotation, l’utilisation de légumineuses en culture principale et en CIMS (Culture Intermédiaire Multi-Services), le désherbage mécanique superficiel, le décalage des dates de semis, l’utilisation de variétés multi-tolérantes seules ou en mélange et l'enrichissement du sol en matière organique.
Mots clés :
Réduction du travail du sol - 0 glyphosate - 0 SMOC - Tendre vers ACS
Caractéristiques du système
|
Rotation : La rotation du système est menée sur quatre ans et propose une culture d'hiver, une culture d'été et deux cultures d'été à cycle décalé (pois chiche et maïs dry). Le système TCS a été expérimenté sur quatre parcelles du dispositif (parcelles IA, ID, IH et II). Interculture : Cultures intermédiaires systématiques sur toutes les intercultures longues. Entre le pois chiche et le maïs : une succession des deux intercultures : (1) sorgho fourrager, en été ; (2) féverole, navette, vesce pourpre et phacélie, en automne. Le choix des espèces des CIMS a pu varier au cours de l'expérimentation. Gestion de l'irrigation : Limitation de l'utilisation de l'irrigation. Fertilisation : Engrais minéraux sur le maïs, le tournesol et le blé tendre. Epandage ponctuel de compost à base de déchets verts. Travail du sol : Travail du sol superficiel, labour en ultime recours. Infrastructures agro-écologiques : Bandes enherbées autour des parcelles.
|
sdc = système de culture |
|
Agronomiques |
|
| Environnementaux |
|
|
Maîtrise des bioagresseurs |
|
|
Socio-économiques |
|
Seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma.
| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Désherbage mécanique | Désherbage mécanique en culture à l’automne et au printemps suivant la météo (houe rotative, herse étrille et bineuse) : détruire les adventices en culture sans détruire la culture. | Ce levier a permis de globalement réduire le recours aux herbicides à l’échelle de la rotation, avec une efficacité globalement satisfaisante, mais au prix d’une augmentation des passages dans la parcelle. Le rattrapage possible avec des herbicides offre une sécurité. |
| Faux semis en interculture | Faire lever les adventices en interculture et les détruire avant le semis. | Efficacité difficile à estimer. |
| Diversification des cultures | Diversification des périodes de semis. Alternance cultures hiver et été, dicotylédones et graminées afin de contrôler les flores adventices de printemps et d’hiver. | Efficacité difficile à estimer. |
| Introduction de couverts en interculture | Par leur développement, les couverts vont concurrencer les adventices durant l'interculture. | Au cours de l’expérimentation, peu de couverts ont été suffisamment denses pour jouer ce rôle. Le seul couvert qui a produit une quantité de biomasse intéressante et ainsi une limitation du développement des adventices est le couvert navette (ou radis f.) – féverole – phacélie – vesce semé avant le maïs en 2021 et avant le tournesol en 2022. |
Seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma.
| Leviers | Principes d'action | Enseignements |
| Semis tardif | Décalage de la date de semis du blé tendre en fin d’automne/début hiver pour éviter la pression des pucerons d'automne. | Ce levier a pu être mobilisé lors de chaque campagne. Il n'y a pas eu de pression des pucerons relevée sur le blé tendre. |
| Semis dans des conditions favorables à une levée rapide | Développement rapide des plantes, les rendant moins sensibles aux attaques de volatiles au semis. | Lorsque ce levier a bien été mobilisé sur le tournesol, il a permis de se prémunir des dégâts de volatiles à la levée. Il est important de cibler la fenêtre de semis dont les conditions permettent un développement rapide des plantes. Cette fenêtre est généralement assez tardive en mai voire fin mai mais potentiellement plus précoce les années exceptionnelles comme 2022. |
| Mise en place d'effaroucheurs | Lutte physique contre les volatiles au semis. | Ce levier n'a pas suffit sans autres leviers supplémentaires, notamment sur le maïs et le tournesol où des dégâts de volatiles à la levée ont été fréquemment observés. |
| Biocontrôle - Mise en place des trichogrammes | Les trichogrammes, une fois lâchés dans la parcelle, pondent dans les œufs de pyrales qui ne peuvent donc plus causer de dégâts à la culture de maïs. | Ce levier a été une réussite pour lutter contre la pyrale du maïs, sauf en 2019. |
L'utilisation de fongicides a été très rare au cours de l'expérimentation (1,75 IFT au total sur maïs et 0,8 au total sur tournesol).
Au cours de cette expérimentation, les maladies n’ont globalement pas posé problème pour la réussite des cultures du système TCS. Il est cependant difficile d’affirmer avec certitude que les leviers mis en œuvre soient totalement responsables de ce résultat étant donné que des traitements fongicides ont été utilisés notamment sur le blé et le maïs. Les principaux leviers mobilisés (hors traitements chimiques) pour la gestion des maladies sont :
- Le choix de variétés résistantes/ tolérantes
- Le mélange variétal, levier mobilisé sur le blé tendre en 2019, 2020
- Le choix d’espèces assez peu sensibles aux maladies (pois chiche, tournesol)
- L’allongement de la rotation : augmenter le temps de retour d’une même culture sur une parcelle
Performances agronomiques :
|
() référence Occitanie en conventionnel. Le code couleur indique le niveau de satisfaction, défini en fonction de l'atteinte de l'objectif initial et de la référence régionale : vert = satisfaisant ; orange = moyennement satisfaisant ; rouge = non satisfaisant |
Tableau 1 : des cultures du système innovant et niveau de satisfaction (références régionales)
Blé tendre
Les rendements obtenus par le blé tendre sont globalement très bons au cours des quatre années d’expérimentation notamment par rapport aux références régionales. Le résultat de 2022 est bien en deçà de l’objectif mais reste correct étant donné les dégâts importants de lapins à la levée et les conditions exceptionnellement sèches qui ont impacté les rendements des cultures.
Tournesol
Le bilan est correct pour le tournesol, notamment par rapport aux références régionales. Hormis les conditions climatiques qui ont été globalement difficiles, en particulier en 2022 dans un contexte de limitation de l’irrigation, le principal problème qui a impacté le tournesol a été les attaques de volatiles au semis en 2019 et 2022.
Pois chiche
Le bilan est assez mauvais : l’objectif de rendement n’a jamais été atteint sur les quatre campagnes. Ces résultats s’expliquent principalement par deux facteurs :
- des mauvaises conditions d’implantation : trop humide pour le pois chiche
- des périodes de sècheresse durant le cycle, notamment en 2020 et 2022, conjuguées à la limitation de l’utilisation de l’irrigation.
Maïs Dry
Les rendements obtenus pour le maïs dry sont globalement faibles et variables d’une année à l’autre. Le peuplement a rarement été atteint à cause des conditions pédoclimatiques (sècheresse en 2019, hydromorphie en 2020, coup de froid au semis en 2022) et des dégâts de volatiles. La présence de CIMS et leur destruction non optimale a été un facteur aggravant en 2022.
De plus, le maïs dry a été assez impacté par les conditions très sèches, notamment en 2019 et 2020 sans ou avec peu d’irrigation au moment de la floraison.
Performances économiques :
Les performances économiques seront discutées en même temps que les indicateurs économiques dans la section "Evaluation multicritère" ci-après.
Performances environnementales :
Les performances environnementales seront discutées en même temps que les indicateurs environnementaux dans la section "Evaluation multicritère"ci-après.
Le résultat des calculs des indicateurs de performances du système TCS est représenté ci-dessous. Ces résultats sont mis en comparaison avec ceux obtenus par le système de référence « blé dur – tournesol ».
Le graphique permet d’apprécier visuellement pour chaque indicateur si le système TCS (représenté par le polygone noir) est meilleur que le système de référence. Plus le sommet du polygone est éloigné du centre du graphe meilleur est le système TCS par rapport au système de référence pour l’indicateur en question.
Performances environnementales
IFT
Le système TCS obtient un IFT total moyen plus faible que celui obtenu par le système de référence (respectivement 1,3 et 2,3). Les IFT herbicides moyens sont assez proches entre les deux systèmes (0,83 pour Ref et 0,63 pour TCS), la différence se faisant essentiellement sur les fongicides et insecticides (1,4 pour Ref et 0,66 pour TCS). Le système TCS a globalement été assez économe, aussi bien en fongicides et insecticides qu’en herbicides, notamment grâce au pois chiche et au tournesol. Le maïs augmente la moyenne du système, notamment à cause de l’utilisation d’herbicide à toutes les campagnes pour un IFT herbicide moyen égal à 1 ; ainsi que l’utilisation ponctuelle de semence traité (dont un resemis) et d’insecticides. L’IFT a été assez élevé pour le blé dur du système de référence, notamment les deux premières années avec plus de protection fongicide que sur le blé tendre du TCS. Il n’y a pas eu de différence entre les deux blés en terme d’IFT herbicide moyen (0,83 pour Ref et 0,82 pour TCS).
En moyenne sur toute la rotation, il y a eu moins de produits phytosanitaires utilisés dans le système en TCS que dans le système de référence. De plus, la proportion de produits classés CMR par rapport au nombre de produits total utilisés est inférieure pour le système TCS, le risque de toxicité est donc inférieur pour ce système. A noter que les blés ont été les cultures pour lesquelles le plus de produits classés CMR ont été utilisés.
Fertilité des sols
Le bilan azoté des deux systèmes est excédentaire (190 kg N/ha pour Ref et 182 kg N/ha pour TCS). Cela s’explique par l’apport de compost à base de déchets verts. Bien qu’il soit très pauvre en azote (0,7 % de la masse), les quantités importantes épandues expliquent les entrées importantes d’azote dans le système, d’autant plus que la biomasse n’est exportée dans aucun des systèmes. À noter que ces entrées comptabilisées dans le bilan correspondent en grande partie à de l’azote organique, qui est très faiblement minéralisé, et donc moins sensible à la lixiviation.
La rotation du système de référence n’intégrant pas de légumineuses, la proportion de légumineuses dans la rotation est forcément meilleure pour le système TCS avec la présence du pois chiche et de légumineuses dans certains mélanges des couverts de sa rotation.
Pour ce qui est de l’érodabilité du sol, les deux systèmes obtiennent des résultats assez faible et similaires qui n’explique en partie par la topographie des systèmes situés en vallée et donc moins sensible à l’érosion que des systèmes qui seraient situés en coteau.
Pour le système TCS, le bilan carbone est inférieur à celui du système de référence, mais le bilan reste très positif pour chaque système. Sur un échantillonnage réalisé sur chaque parcelle des systèmes, on mesure en moyenne, sur la parcelle où a été expérimenté le système de référence, une hausse de 34,7 t de carbone par hectare sur les 30 premiers centimètres, et une hausse de 28,6 t C/ha en moyenne sur celles où a été expérimenté le système en TCS. Ces fortes hausses sont satisfaisantes, mais elles sont sans doute à mettre au crédit des apports importants de compost lors des deux dernières campagnes, et même d’un troisième apport juste après les récoltes de la dernière campagne.
Performances économiques
L’objectif lié à la marge semi-nette n’est pas atteint pour le système TCS (40% de la référence au lieu de 90%).
Ces résultats s’expliquent principalement par la présence de cultures comme le pois chiche qui sont mal valorisées (prix conventionnel) dans ce système et donc moins rentables. La faible productivité de certaines cultures (pois chiche, maïs) qui n’est pas compensée par la réduction des charges, impactent également la marge semi nette à l’échelle du système. Les charges liées aux semences bien supérieures pour le système TCS par rapport au système de référence (146 € en moyenne pour la référence (+/-32) contre 274 (± 114) € pour TCS. Ces charges liées à la semence des cultures et des couverts expliquent aussi l’efficience économique des intrants inférieure des systèmes innovants qui se retrouvent un peu plus dépendants aux intrants de manière générale que le système de référence.
Performances sociales
La diversité des cultures présente dans le système TCS a pour conséquence une augmentation de l’utilisation d’outils de destruction et de préparation du sol consommateurs en carburants (herse rotative notamment). Cela se traduit par une augmentation de la consommation de carburants entre le système de référence (45 L/ha) et le système TCS (116 L/ha) et du temps de travail (3 h/ha pour Ref contre 7 h/ha pour TCS).
* A compléter
* A compléter
Le système testé qui caractérise une transition vers un système ACS était basé sur une rotation regroupant 4 cultures du Lauragais (blé tendre, tournesol, maïs et pois chiche).
Les performances multicritères du système comparé à une référence blé dur tournesol, soulignent des performances environnementales marquées (IFT, diversité, sol) mais des performances économiques assez faibles liées aux difficultés d’assurer le peuplement (qualité du semis et volatiles), au dérèglement climatique avec des périodes sèches très marquées et aux charges supplémentaires générées par les intercultures. Ces difficultés ont particulièrement impacté la réussite du maïs dry et du pois chiche. La culture du pois chiche montre ses limites en terme de rentabilité dans un système avec valorisation en agriculture conventionnelle. Ces difficultés ont surtout impacté la rentabilité économique du tournesol, une culture dont les rendements obtenus sont en accord avec les références régionales. La réussite du blé tendre confirme que cette culture est une valeur sûre des systèmes de culture du Lauragais.
Au terme de la rotation, l’arrêt du travail profond est effectif mais la durée relativement courte de la rotation ne permet pas d’apprécier finement l’impact, notamment sur les adventices.
L’évolution du C dans le sol est significativement positif, en lien avec les 120t/ha de compost apporté et probablement la présence de couvert.
La couverture de l’interculture a pris de l’ampleur au fil du projet et des biomasses intéressantes (autour de 5t/ha) ont été obtenues sur certains mélanges testés. L’absence d’irrigation post blé tendre a tout de même pénalisé certains couverts. Les couverts peu denses n’ont pas permis de contenir le développement des adventices. On note la difficulté de réussir un couvert sans semis combiné voire sans un travail superficiel supplémentaire avant le semis.
L’arrêt du glyphosate et le maintien d’un semis avec travail superficiel du sol a compliqué la phase de destruction et de semis, avec une multiplication du travail superficiel de préparation et un lit de semence imparfait lorsque la biomasse du couvert était importante (et un peuplement en conséquence).
La suppression du S-métolachlore n’a posé des difficultés que sur tournesol et maïs. Deux autres molécules (ZNT 20m) ont été utilisées et l’intensification du désherbage mécanique a été nécessaire pour contenir les adventices, dans un contexte fréquent de défaut de peuplement et de réduction de la dose d’herbicide.