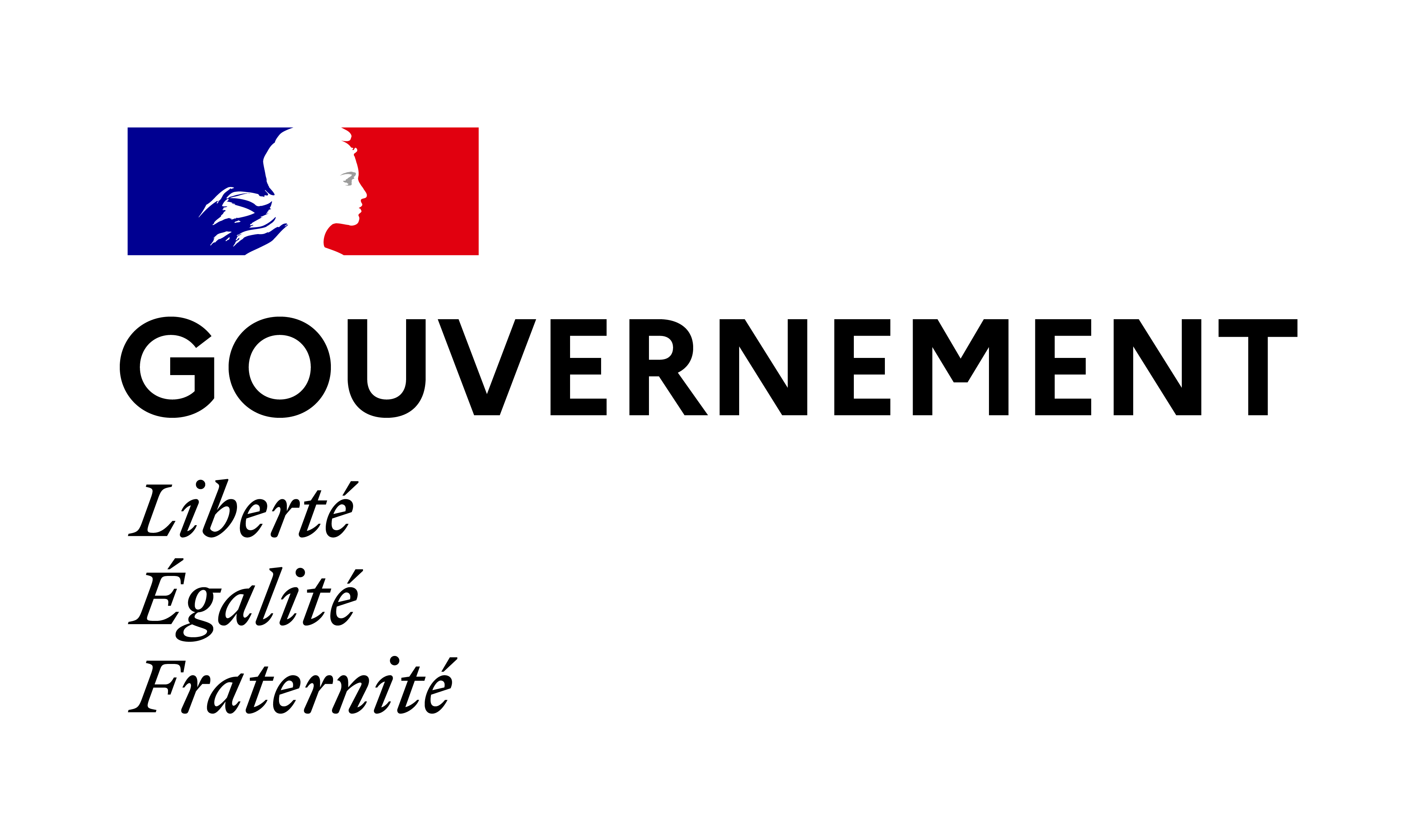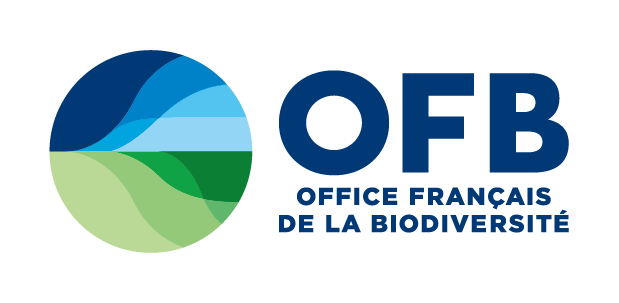Projet PERSYST-Maraîchage

Les systèmes maraîchers biologiques diversifiés se développent de façon continue dans l’Ouest de la France. Mais le faible, voire le non-recours, aux produits phytosanitaires dans ces systèmes complexes participe à une multiplication des tâches et une utilisation intensive du sol, mettant en cause leur durabilité agronomique, sociale et économique. Le projet PERSYST-maraîchage vise à co-construire et expérimenter de nouveaux systèmes de culture permettant d’augmenter la durabilité des systèmes maraîchers biologiques diversifiés, selon 2 axes majeurs : la fertilité du sol et d’organisation du travail.
Enjeux et objectifs
L’entretien de la fertilité du sol repose sur le postulat qu’un sol bien nourri et fertile permet aux plantes de se développer correctement et de mieux se défendre contre les maladies et ravageurs.
Plusieurs leviers d'amélioration de la fertilité des sols, comme la réduction du travail du sol, la mise en place de bonnes pratiques de gestion des engrais verts, l'allongement des rotations, l’utilisation de paillis sont ainsi testés et évaluées au sein du projet PERSYST-maraîchage.
Au-delà de leurs conséquences agronomiques, l’impact de la mise en place de ces leviers sur l’organisation du travail au sein des fermes est étudié. La main d'oeuvre est le premier facteur de production en maraîchage diversifié, et la diversification des cultures, combinée à des approches prophylactiques implique souvent une charge de travail et une pénibilité importantes.
Stratégies testées
Pour atteindre ces objectifs, PERSYST-maraîchage se base sur plusieurs dispositifs coordonnés :
- Le recensement et l’évaluation des stratégies innovantes de gestion de la fertilité des sols et du cuivre déployées dans les systèmes de culture en maraîchage diversifié bio du Grand-Ouest. 39 fermes maraîchères ont ainsi été enquêtées en 2019. Des fiches pratiques décrivant les leviers innovants mis en oeuvre sur ces fermes sont disponibles.
- Des réflexions multi-acteurs sur les combinaisons de leviers permettant d’augmenter la durabilité de ces systèmes : ateliers de co-conception de nouveaux systèmes de culture, rencontres entre maraîchers autour des innovations testées...
- L’expérimentation de 2 systèmes de culture reconçus collectivement sur le site expérimental de la P.A.I.S. (Morlaix, 29), au regard d'un système de culture de référence sur 4 ans (2020 -2023) :
- Système de culture de référence : représentatif des pratiques du secteur. Caractérisé par des labours systématiques à 30 cm ; des paillages plastiques sur courges et oignons ; des apports de 20 tonnes par hectare de fumier bovin au printemps avant labour.
- Système de culture "Apports verts" : caractérisé par un objectif de travail du sol réduit (pas de labour, et pas d'outils animés) et une recherche d'autofertilité du système par la une maximisation des couverts et les apports de biomasse végétale. Les passe-pieds sont permanents. L’IFT le plus limité possible.
- Système de culture "non travail du sol" : caractérisé par le strict non travail du sol. Un apport carboné massif (compost de déchets verts) est réalisé en année 1, dans le but de stimuler la biomasse microbienne. Par la suite l'apport de compost est renouvelé avant semis de carottes.
- La mise en œuvre et l’évaluation de leviers d'amélioration de la fertilité des sols sur 10 fermes de Bretagne et Pays de la Loire (plein-champ et sous-abris). Les systèmes de culture reconçus et suivis sur ces fermes seront évalués durant 4 ans (2020-2023), dans une logique de re-conception "pas à pas".
Des résultats directement mobilisables par les producteurs
Le transfert de résultats est au coeur du projet PERSYST-maraîchage. Par le biais de visites de sites régulières, des témoignages audio/vidéo et écrits et l'organisation d'événements professionnels, les pratiques innovantes, leurs limites et leurs facteurs de réussites seront diffusés largement à la profession. Ainsi, au-delà des références acquises, le projet vise à capitaliser les processus d’apprentissage, d’essais-erreurs et d'adaptations de systèmes, à partir des essais menés sur fermes.