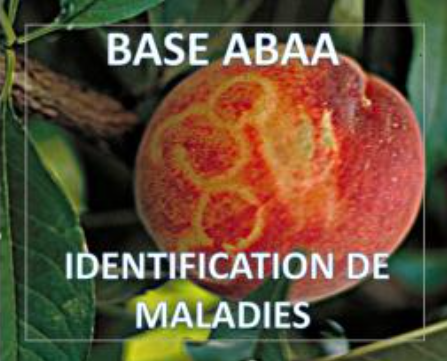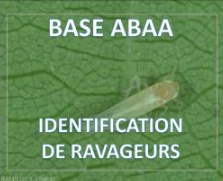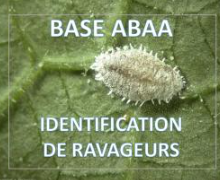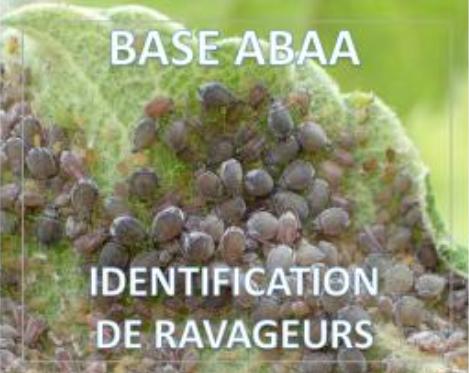Virus phytopathogènes et Protection intégrée des cultures

Les phyto-virus, également connus sous le nom de virus des plantes, représentent une classe diverse d'agents pathogènes qui infectent une grande variété de cultures végétales dans le monde entier. Ces micro-organismes minuscules peuvent causer des maladies dévastatrices chez les plantes, entraînant des pertes de rendement importantes et menaçant la sécurité alimentaire.
Ils se propagent souvent par des vecteurs tels que les insectes, les acariens ou par des pratiques agricoles comme la propagation végétative. Selon la classification actuelle, il existerait trente-trois genres de virus affectant les plantes, répartis en neuf familles ; on en connaît plus de mille différents. Comprendre la nature et la dynamique des phyto-virus est crucial pour développer des stratégies de gestion efficaces et protéger nos systèmes alimentaires.
Définitions, symptômes et modes de contamination et de propagation des virus végétaux
Quelques définitions
Les virus sont des entités infectieuses infiniment petites, invisibles au microscope optique. Leur structure est simple : une coque protéique, la capside, renfermant un acide nucléique qui est bien souvent de l’ARN (acide ribonucléique) chez les virus phytopathogènes. Les virus sont obligés de vivre dans les cellules de leur plante hôte dont ils détournent le système enzymatique à leur profit. Ils sont alors à l'origine de viroses = maladies qui se développent lors de l'infection d'une plante par un virus. Consulter la page du site Ephytia pour en savoir plus sur les virus en général.
Dégâts provoqués par les virus végétaux
Les phyto-virus peuvent infecter les tissus des racines, des tiges ou ceux des feuilles; entrainant une maladie généralisée du végétal.
- Dégâts sur le feuillage : Souvent, le feuillage prend un aspect de « mosaïque » : coloration irrégulière des feuilles. Les feuilles peuvent aussi se déformer : taille réduite, aspect gaufré ou longiligne, apparition de cloques… Enfin, elles peuvent se nécroser, jaunir et sécher.
- Dégâts sur la floraison et la fructification : Les fleurs se nécrosent et avortent. Il n'y a donc plus ou très peu de fruits ou légumes. Ceux qui persistent sont plus petits et nécrosés, mûrissent plus lentement et sont peu appétissant. Ces symptômes sont souvent liés à une infection des racines.
- Dégâts sur les tiges : la croissance des tiges ralentit et des nécroses apparaissent également. Les plants s'étiolent.
Transmission des phyto-virus.
Les phyto-virus peuvent se transmettre de deux façons :
- à partir de tissu végétal issu d'une plante infectée : boutures, graines, multiplication de tubercules, rhizomes ou bulbes ;
- par vecteur = organisme vivant capable de prélever, transporter et inoculer un virus à une plante-hôte: il s'agit principalement d'insectes piqueurs-suceurs (pucerons, cicadelles, cochenilles, thrips…), mais aussi d'acariens, de champignons microscopiques ou de vers. Le site Ephytia propose une page de recherche par vecteurs.
La transmission est différente selon que le virus a la capacité de se multiplier dans le vecteur (mode persistant) ou non (mode non persistant). On distingue un cas intermédiaire où le virus persiste dans l'appareil digestif du vecteur sans pour autant s'y multiplier (mode semi-persistant). (Source Universalis)
Facteurs favorisant les viroses végétales
Plusieurs facteurs peuvent faciliter les infections virales :
- l'environnement des cultures, surtout s'il favorise la présence d'insectes piqueurs-suceurs et de plantes réservoirs
- le climat : des hivers doux favorisent la précocité et l'importance d'épidémies à virus car ils mettent en présence simultanée des plantes adventices et des parasites; alors que des hivers plus rigoureux, détruisent ces réservoirs de vecteurs et de virus, réduisant ainsi leur fréquence et leur importance. Le ruissellement et l'érosion peuvent faire circuler un virus transmis par des vecteurs situés dans le sol comme les nématodes.
- la présence de vecteurs très mobiles tels que les pucerons ailés augmentera la vitesse de diffusion de ces virus à toute une parcelle de terrain cultivée en quelques semaines, alors que d'autres vecteurs qui se déplacent très peu, tels que des nématodes, ne les diffuseront que de quelques mètres par an.
Ressources d'identification disponibles
🔎Fiches ABAA Identification des principales maladies virales
🔎Fiches ABAA Identification des principaux vecteurs de maladies virales:
➡️Pucerons
Méthodes de lutte
Il n'existe pas actuellement de traitements curatifs des viroses végétales, il est donc essentiel de mettre en place des méthodes préventives. Plusieurs ont fait leur preuve et doivent souvent être combinées pour optimiser leur efficacité.
Surveillance et contrôle des plants
Lorsqu'un nouveau virus émerge, un dispositif de surveillance, lutte et prévention peut être mis en place au niveau national pour contrer son arrivée sur le territoire. Un tel dispositif pour le virus ToBRFV de la tomate avait été mis en place (voir ci-contre).
Ajouté à cette surveillance à l'échelle nationale, un programme de contrôle et de certification des plants et semences permet de vérifier leur état sanitaire au moment de leur achat ou importation. La certification atteste ainsi de la qualité sanitaire des plants et semences. Chaque secteur agricole a mis en place des processus de certification adaptés aux contraintes de chaque filière. certification fruitière et certification des bois et plants de vigne. SEMAE s'occupe de son côté du contrôle et de la certification pour les grandes cultures et cultures légumières.
Grâce au contrôle des végétaux, on ne trouve dans le commerce que des végétaux garantis sans virus par leurs fournisseurs. Mais il faut tout de même être vigilant et n'acheter, ne planter et ne multiplier que des végétaux dont on est sûr qu'ils sont exempts de virus, qu'il s'agisse de graines, de bulbes, de tubercules ou de rhizomes.
Ressources Méthodes de lutte
🔭Dispositifs de surveillance, lutte et prévention:
➡️Dispositif national contre le virus émergent de la tomate (ToBRFV)
➡️L'ANSES met en garde contre un virus émergent
🛠️Outils disponibles
➡️🍇Reconnaitre les principales viroses de la vigne
➡️🟡Les fiches de gestion intégrée des bioagresseurs de la betterave sucrière
Résistance variétale
Les variétés résistantes et tolérantes aux virus constituent une stratégie de lutte efficace. Cependant, face à l'utilisation massive de telles variétés, des contournements de résistances peuvent apparaître. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies de gestion des résistances à l'échelle des territoires. La lutte contre la rhizomanie et les autres maladies virales de la betterave est un exemple qui illustre bien ce propos.
L'outil myVar développé par Terres Inovia est alors très utile pour sélectionner la variété la plus adaptée à son contexte en colza, tournesol, pois, lin, soja, chanvre et féverole.
Environnement cultural
Pour limiter efficacement la propagation des phyto-virus dans les parcelles agricoles, une gestion minutieuse de l'environnement cultural est indispensable. Cela implique d'abord l'élimination des vecteurs de transmission, tels que les insectes porteurs de virus, à travers l'utilisation de méthodes intégrées ou l'application de traitements insecticides ciblés.
En outre, la suppression des plantes hôtes adventices, qui peuvent agir comme des réservoirs de virus, est cruciale. Cette suppression peut être réalisée par le désherbage manuel ou mécanique, ainsi que par l'application d'herbicides sélectifs.
Une rotation des cultures judicieuse contribue également à réduire la pression virale en empêchant la multiplication des agents pathogènes spécifiques à certaines espèces végétales. En combinant ces pratiques et en adoptant une approche intégrée de la gestion environnementale, il est possible de prévenir efficacement les infections virales et de protéger la santé des cultures.
Nettoyage des outils de travail du sol, de taille, de récolte et de transport
Les outils mécaniques, manuels ou motorisés utilisés dans les travaux agricoles peuvent être des vecteurs de dissémination d’organismes nuisibles surtout pathogènes contenus dans des débris de végétaux ou sur de la terre présente en surface de ces outils. Il donc important de les désinfecter et nettoyer entre différentes interventions.
Dans ce cadre, la désinfection des outils à l’aide de solutions désinfectantes permet d’empêcher ce phénomène. Ces solutions sont principalement des solutions à base de 10% d’hypochlorite de sodium ou de 70% d’alcool. 3 substances de base sont utilisable pour la désinfection des outils : vinaigre, péroxyde d’hydrogène et lait de vache.
En plus de permettre de lutter contre les phyto-virus, ces différents nettoyages sont aussi un bon moyen pour lutter contre la propagation des graines d'adventices




Recherche et innovation
Des projets thématiques:
Le projet de recherche ABCD_B a pour objectif d’évaluer des solutions pour la protection contre les maladies à virus transmises par des pucerons sur les principales grandes cultures : céréales à paille (B/CYDV), colza (TuYV), betterave (BMYV). Deux stratégies sont à l'étude : la voie génétique (résistances et tolérances variétales) et les produits de biocontrôle pour lutter contre les pucerons et la propagation des viroses dans les parcelles cultivées. Plus de détails dans la description du projet ci-contre.
Le projet PLANTSERV, quant à lui, prévoit de comparer deux régions (Pays de Loire-Bretagne) pour produire une méthode de lutte contre le virus de la JNO (Jaunisse Nanisante de l'Orge) grâce aux plantes de services. Plus de détails ci-contre.
Plus récemment, le projet AGIR se penche sur la compréhension des comportements des pucerons afin de réduire la transmission virale de la jaunisse de la betterave sucrière. L'objectif principal de ce projet est de combiner deux leviers défavorables à l'installation du vecteur: le recours à des variétés répulsives de betterave et à des plantes de services.
Des micro-organismes utiles et des solutions de biocontrôle
Il existe quelques virus qui peuvent servir pour lutter contre des insectes ravageurs ou des virus. Cette technique alternative est détaillée dans les leviers PIC ci-contre ainsi que sur le site GECO : consulter l'article "Pratiquer la lutte biologique en verger - pulvérisation de micro-organismes".
Parmi les virus utiles en termes de biocontrôle, on recense:
- des insecticides biologiques qui permettent de lutter contre les chenilles phytophages et contre les chenilles foreuses des fruits grâce à différentes souches de virus de la granulose.
- des stimulateurs de défenses des plantes qui permettent de lutter contre des virus via le mécanisme de la "protection croisée". On introduit des isolats peu virulents du virus qui colonisent les plantes rapidement et les protègent contre de nouvelles attaques par des isolats agressifs du même virus. Une plante infectée par un isolat d’un certain virus ne peut plus être infectée avec un autre isolat du même virus. Cela concerne actuellement deux virus : le virus de la mosaïque du Pépino et le virus de la mosaïque jaune de la courgette





Enfin, il est aussi possible de lutter directement contre les vecteurs des virus en stimulant la lutte biologique (lutte par conservation, par acclimatation ou par augmentation) au niveau de la parcelle. Ajouté à cela, il existe aussi plusieurs solutions de biocontrôle d'origine naturelle utilisables directement contre ces vecteurs. Ces différentes solutions sont couvertes par des CEPP.
Conclusion
Pour conclure, les phyto-virus affectent un très large panel de cultures et aucune filière n'est épargnée. Une fois contaminée, la plante est bien souvent condamnée, ce qui fait que la lutte doit se réaliser en amont de la contamination, grâce à des mesures prophylactiques et de la protection intégrée.
Plusieurs solutions se présentent mais celles qui fonctionnent le mieux et qui sont le plus faciles à mettre en place concernent la gestion des vecteurs de ces virus: lutte biologique, stratégies push-pull et recours à des solutions naturelles de biocontrôle. En plus de ces mesures, plusieurs mesures doivent être mises en place aux différentes échelles de l'agriculture, des systèmes de surveillance et dispositifs nationaux aux projets de recherche par filière jusqu'au nettoyage des outils de taille et de transport sur l'exploitation.