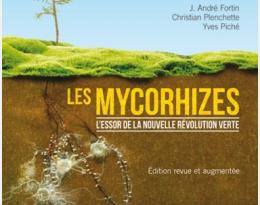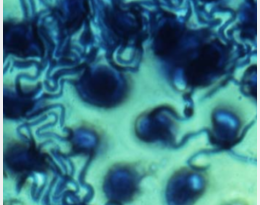Les biostimulants : des microorganismes et substances naturelles pour protéger des stress abiotiques
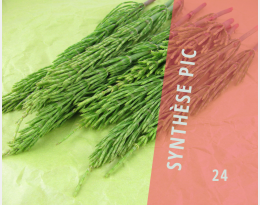
Les biostimulants des plantes, aussi appelés phytostimulants, regroupent des substances d’origine naturelle ou des microorganismes permettant aux cultures d'être plus productives et plus résistantes aux facteurs abiotiques, comme le gel, la sécheresse, la salinité, la structure du sol… La définition formelle du ministère de l'agriculture définit les biostimulants comme suit :
"Produit qui est utilisé pour stimuler l'absorption des nutriments et permettre une meilleure utilisation de ceux-ci par les plantes cultivées, pour renforcer la résistance de ces plantes aux agressions abiotiques, ou pour améliorer la qualité des récoltes." - Légifrance
Dans le cadre de la protection intégrée des cultures, les biostimulants attirent beaucoup l’intérêt dans un objectif de mettre la plante dans de bonnes conditions, ce qui permet la réduction des fertilisants minéraux, une meilleure résilience des cultures aux aléas météorologiques amplifiés par le changement climatique et une réduction des produits phytopharmaceutiques conventionnels.
Aspects réglementaires
Il faut différencier les biostimulants, qui protègent contre les stress abiotiques, des produits de biocontrôle et des stimulateurs des défense des plantes qui permettent quant à eux de lutter contre les stress biotiques (agents pathogènes, ravageurs, adventices…). Cependant, des substances ou organismes ayant un effet biostimulant peuvent également être reconnus pour un effet de biocontrôle et la limite entre ces catégories est parfois ténue. Pour en savoir davantage sur les synergies et évolutions entre les biostimulants et le biocontrôle, consultez le webinaire d’agreenium ci-contre. Les substances considérées comme biostimulantes sont divisées en deux catégories réglementées : les substances naturelles à usage biostimulant et les matières fertilisantes et supports de culture.
Les substances naturelles à usage biostimulant
Les substances naturelles à usage biostimulant (SNUB) sont un des composants des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) qui sont des préparations simples ne nécessitant pas d'autorisation de mise sur le marché pouvant être commercialisées et utilisées pour la lutte contre les stress abiotiques avec une relative simplicité. Accessible aux professionnels comme aux particuliers, les SNUB sont des substances d'origine végétale, animale ou minérale, mais pas de microorganismes, pouvant appartenir à trois catégories :
- Référencées dans la liste de plantes ou parties de plantes inscrites à la pharmacopée pouvant être commercialisées par des personnes autres que des pharmaciens dont la liste est disponible ici.
- Répondent aux exigences du cahier des charges plantes consommables : la préparation végétale doit être issue de la partie consommable de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, doit être facile à réaliser et avoir un effet biostimulant reconnu par des tests ou des savoirs ancestraux.
- Ayant obtenu une autorisation de l'ANSES : actuellement seule la prêle des champs et le saule en font partie (voir ci-contre).
Toutes ces substances peuvent être utilisées en agriculture biologique. Les conditions d'emploi (stockage, préparation, utilisation…) sont détaillées dans ce guide réalisé par l'ITAB. A noter que certaines SNUB sont également des substances de base (SB) et donc peuvent revendiquer à la fois une action biostimulante et phytosanitaire, comme c’est le cas pour la prêle des champs et le saule.

Les matières fertilisantes et supports de culture
Les biostimulants ne faisant pas partie des SNUB doivent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSES ou d'une certification CE (règlement UE 2019/1009) pour être commercialisés et utilisés en agriculture. Dans la réglementation française, les biostimulants n'ont pas de catégorie à part entière, mais sont inclus dans les Matières Fertilisantes et Supports de Culture (MFSC) sous diverses appellations : additif agronomique, préparation bactérienne, préparation fongique… Contrairement aux SNUB, les MFSC peuvent contenir des microorganismes, en plus de substances végétales ou minérales.
De nombreux principes actifs aux effets variés
Les produits à base de microorganismes
De nombreuses bactéries et champignons présentent des effets biostimulants pour les cultures par leur activité métabolique et à la production de molécules qui promeuvent la croissance ou la résistance des plantes. Naturellement présents dans les sols, ces microorganismes sont isolés et multipliés en laboratoire afin d’en extraire les molécules d’intérêt ou de tout simplement pouvoir les inoculer vivants aux cultures.
Les bactéries présentant un effet biostimulant sont des rhizobactéries, aussi connues sous le nom de PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Comme leur nom l’indique, les rhizobactéries s’implantent dans la rhizosphère, ou dans les nodules dans le cas des légumineuses, dans une relation symbiotique avec la culture. Leurs effets sont multiples : amélioration de la fertilité du sol, stimulation de la croissance, résistance aux stress abiotiques et protection contre les organismes pathogènes.
Également présentes au niveau des racines, les mycorhizes sont certainement les microorganismes du sol les plus connus et les plus étudiés. Ces champignons symbiotiques permettent à la plante d’exploiter une plus grande partie du volume du sol ainsi que ses ressources nutritionnelles et son présentes naturellement sur la majeure partie des espèces végétales, exceptées les brassicacées (colza, choux…) et les chénopodiacées (betteraves, épinards…). Il peut cependant être utile d’apporter des mycorhizes n’étant pas ou peu présentes dans le sol via l’application de biostimulant afin d’améliorer la nutrition de la culture, la protéger d’agents pathogènes ou encore stimuler ses défenses naturelles. Certaines pratiques agronomiques étant défavorable aux mycorhizes, comme un travail du sol trop intense ou l’application de fongicides, il peut être nécessaire d’adapter son itinéraire de culture afin de les préserver.

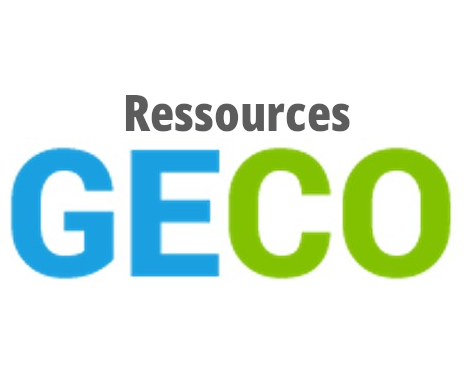 Ressources GECO sur les mycorhizes
Ressources GECO sur les mycorhizes
• Favoriser le développement de mycorhizes
• Cultiver des espèces à mycorhizes
• Multiplier et inoculer des champignons mycorhiziens indigènes
Les mycorhizes ne sont pas les seuls champignons utilisés comme biostimulants. Il existe d’autres champignons de la rhizosphère, des levures ainsi que des champignons endophytes bénéfiques. Ces derniers sont présents au sein même des tissus de la culture et permettent une croissance plus rapide, ce qui réduit sa vulnérabilité notamment lors de la levée (voir ci-contre).
Les produits à base de végétaux
Les préparations à base de végétaux se présentent sous diverses formes : décoctions, macérations, infusions, huiles essentielles… L’objectif étant de rendre disponible à la culture les molécules à effet biostimulant présentes dans ces végétaux. On peut citer des substances faisant partie des SNUB, comme l’infusion de menthe, la fermentation de consoude ou encore l’huile essentielle de clou de girofle (voir ci-dessous).
Par leur effet biostimulant, certaines de ces substances sont utilisées pour fortifier la vigne, ce qui lui permettrait de mieux résister au mildiou (voir ci-dessous les articles issus du centre de ressources cuivre), mais par leur statut de biostimulant, ne peuvent pas prétendre avoir un impact sur la capacité de la plante à résister au mildiou.
Certaines espèces d’algues sont également reconnues pour leur effet biostimulant par un usage traditionnel. Ce sont principalement les algues brunes ayant pour effet une meilleure mobilisation par la culture des éléments nutritifs et une amélioration de la croissance, en plus de représenter une source de fertilisation organique.
Il existe encore d’autres substances organiques ayant un effet biostimulant mais qui sont moins utilisées ou encore à l’état de recherche. On peut par exemple citer les acides humiques et fulviques, composés de la dégradation de la matière organique trouvés notamment dans le lombricompost qui augmenteraient la disponibilité des nutriments pour la culture, ou les hydrolysats de protéines, produits d’une transformation des protéines qui auraient de nombreux bienfaits, comme une meilleure assimilation des nutriments, une production d’énergie accrue et une meilleure réponse au stress.
Les composés inorganiques
Plusieurs composés minéraux sont reconnus comme biostimulants et certains font partie des substances naturelles à usage biostimulant. C’est le cas du silicium, qui permet principalement d’apporter une plus grande flexibilité aux tissus de la culture. On retrouve également le bicarbonate de potassium, le cuivre chélaté et les oligoéléments chélatés qui sont des matières fertilisantes nécessitant une autorisation de mise sur le marché, utilisés pour fortifier la vigne, ce qui lui permettrait de mieux résister au mildiou (voir ci-contre).
Et l’efficacité dans tout ça ?
Le domaine des biostimulants étant attractif et la législation entourant cette appellation étant encore imprécise, il arrive que les effets annoncés sur la culture par le fabriquant ou par les savoir ancestraux ne soient pas complètement retrouvés via des expérimentations indépendantes. Il est parfois difficile de démontrer l’effet réel de ces produits, particulièrement lorsqu’ils sont testés dans des conditions très maîtrisées, différentes de la réalité de terrain. De plus, dans le cas des produits à base de microorganismes, ces derniers ne sont régulièrement pas retrouvés dans les proportions annoncées. Pour en savoir plus sur ces écarts, consultez la présentation du projet RECCABLE ci-contre qui, dans les premières minutes, présente une analyse de plusieurs articles scientifiques portant sur la conformité et l’efficacité très variable des produits biostimulants à base de microorganismes.
Il reste tout de même qu’un certain nombre de biostimulants ont un effet avéré sur les cultures qui y sont sensibles, et qu’il est nécessaire de sélectionner le bon biostimulant pour l’usage souhaité. L’efficacité a également tendance à être réduite en plein champ, comparé à une culture sous abri ou hors sol, et est à utiliser en combinaison avec plusieurs autres leviers.
Des exemples d’application au champ
Plusieurs groupes DEPHY utilisent les biostimulants dans le cadre de leur évolution de pratique. On peut citer plusieurs systèmes pépinière hors sol dans le cadre du projet HORTIPEPI 2, du groupe DEPHY de la Nièvre ou du réseau DEPHY Fleur 83 (voir ci-dessous) mais avec des résultats mitigés ne permettant pas de mettre en évidence un effet des biostimulants.
La recherche et innovation à l’œuvre
En réponse à l’intérêt croissant pour les biostimulants, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a lancé en mars 2024 le Grand défi biocontrôle et biostimulation pour l’agroécologie (GDBBA) qui vise à soutenir la recherche et le déploiement d’alternatives aux produits de synthèse, pour la protection des cultures et leur fertilisation. Ce défi est animé par l’Association biocontrôle et biostimulation pour l’agroécologie (ABBA) qui réunit de nombreux acteurs du biocontrôle et de la biostimulation afin de faire progresser le développement des solutions de biocontrôle et de biostimulation, en s’appuyant en particulier sur l’expérimentation.
Le réseau mixte de recherche (RMT) Bestim, qui prend la suite des travaux du RMT Elicitra, a comme objectif de transférer les connaissances au sujet de l’immunité agroécologique, notamment représentée par les biostimulants, vers le terrain. Le RMT a notamment produit une série de vidéos issues d’un atelier permettant de présenter des méthodes statistiques afin de mieux quantifier l’efficacité des biostimulants.
Plusieurs projets de recherche portant sur les biostimulants sont également en cours. On peut par exemple citer le projet PISTIL : Protection Intégrée, biocontrôle et usage de bioSTImulants pour une intensification écologique des systèmes maraîchers en milieu tropicaL porté par l’IT2. Ce projet a testé une combinaison de pratiques avec du biocontrôle, des biostimulants et des infrastructures agroécologiques (voir ci-contre). L’IT2 organise également le projet Cercotrop afin de lutter contre la cercosporiose noire du bananier dans lequel les biostimulants font parties des leviers testés. On peut également mentionner le projet RECCABLE du CTIFL cité plus haut qui a étudié l’effet d’un panel de substances biostimulantes sur plusieurs cultures légumières. Les premiers résultats ont été présentés au SIVAL 2025 et le support de présentation est disponible sur le site du CTIFL.
En vigne, le projet MISTIC animé par l’IFV vise à tester des synergies entre le biocontrôle et les biostimulants afin d’améliorer l’efficacité de ces traitements.
Pour en savoir plus
La plateforme My Green Training Box (ci-dessus) est un site de e-learning gratuit qui propose 4 modules sur les biostimulants sur plusieurs thématiques : les notions générales, les biostimulants microbiens, les biostimulants non microbiens et des études de cas.
L’académie des biostimulants est un site de l’Afaïa, le syndicat de référence des matières fertilisantes et supports de culture et animé par les producteurs de biostimulants qui a comme objectif d’être un condensé de références techniques et de services au sujet des biostimulants. Il permet de retrouver des références scientifiques et réglementaires sur les biostimulants.